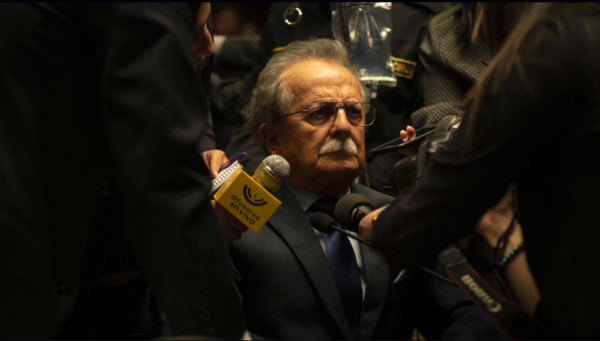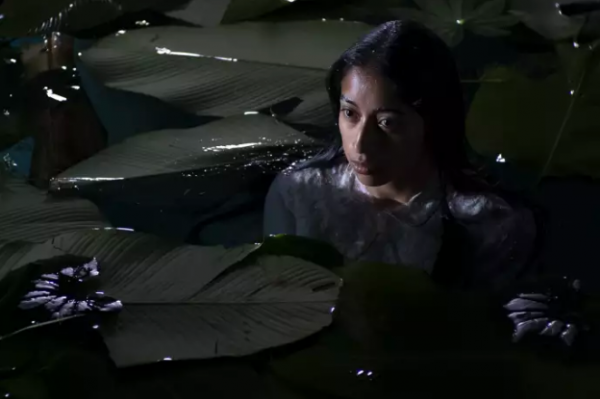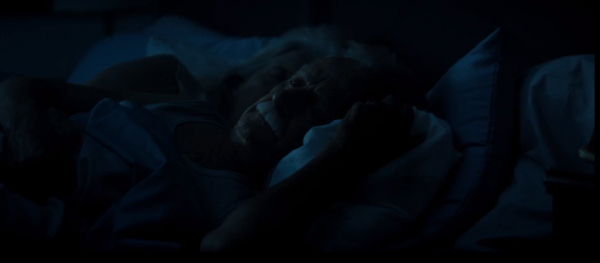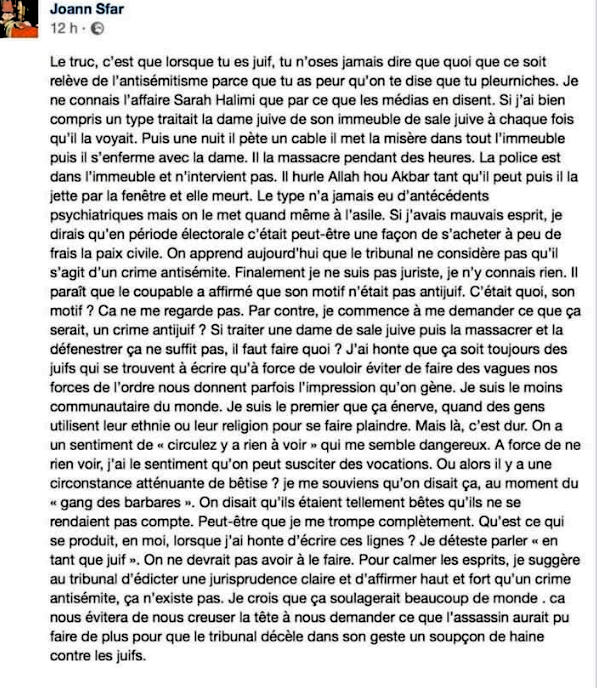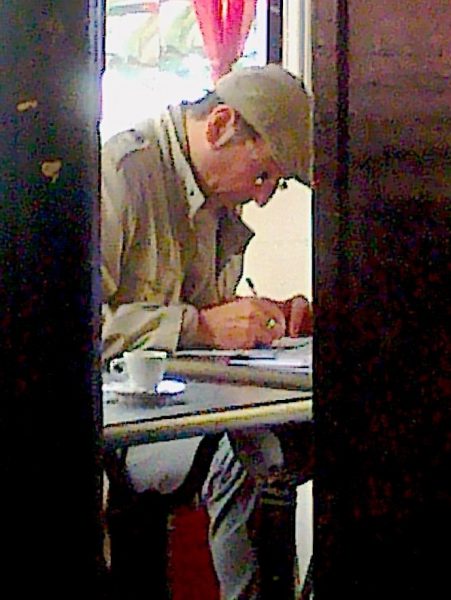Une première carte postale du fond de campagne – le monde est petit, nous lui appartenons – la maison[s]témoin ne va quand même pas se laisser emmerder par une saloperie de bazar (pendant le week-end, d’ailleurs, a été quelques temps infecté – un avis de l’Employée aux écritures (qu’on salue et remercie ici) a permis d’y mettre bon ordre – on revient aussi sur le blog dans les jours qui viennent (si dieu nous prête vie)
Allez je vais faire ça : la maison[s]témoin comme le lieu de l’explicitation du laboratoire – on ne posera des liens que plus tard – on revient le mercredi ? c’est aujourd’hui le troisième du confinement (ce mot, cette saloperie non ? réclusion me plairait plus – il y a sur le bureau un dossier « réclusion » où se trouvent les images du cerisier du matin et de l’après midi (série en cours)) des images de fleurs, des images et des textes – l’Air Nu et son journal de confinement – ce qui nous empêche, et pour ici cette tentative de résolution de ces tirets mis là ou là puis encore ailleurs – pour ne pas terminer la phrase sûrement – pour gagner en indépendance – pour y voir plus clair? c’est pas gagné
Des registres mis à jour, j’espère en tenir deux ou trois dans le même mouvement – je pose deux paragraphes par jour – le dimanche un seul ? un peu de rêve s’il en est le matin mais je ne veux pas non plus généraliser – un peu de vue commune – et beaucoup de souvenirs, cette histoire que je voulais raconter (celle de ma mère, de mon père – il y a dans un des documents que j’ai apportés cet arbre généalogique que j’ai construit avec mon frère un jour au Paris Rome) – et ce qui se passe, peut se passer, s’est passé ici – je suis en villégiature (la nuit du lundi au mardi, on ne l’a pas dormie – ça ne se dit pas mais on s’en fout – on a parlé parlé parlé jusqu’à en avoir des haut-le-cœur pour parvenir à se dire vers quatre heures on s’en va – clics et clacs pris (pas très bien) on s’en est allé – maintenant il faut continuer dans le même temps, la même veine, le même élan – la voiture garée dans le jardin, les sorties interdites et le forfait téléphonique et internet complètement obsolet – ça ne se dit pas non plus – fuck off avec pérenne obsolète et autres joyeusetés contemporaines – ce ne sera jamais la même chose, je ne tiens pas à mettre du son mais je pourrais sans doute (le téléphone étant intelligent et élégant, il fait aussi magnétophone-modem-appareil photo-caméra et couteau suisse) – cette technique que j’agonis (et pourtant, quelle formidable mine de savoir mercantilisé), je la découvre avec cette consommation d’internet (plusieurs dizaines de gigas/jour à Paris, cent mégas de prévu dans le forfait : les types de l’informatique (et les gonzesses, ne soyons pas sectaires ni chiens) s’y entendent pour embourber le pékin (ils font payer les mises à jour chez sphinx, pourquoi se gêner ? les logiciels de comptabilité obligatoire (évidemment) sont dans le même état : poings et pieds liés, nous nous sommes livrés à cette engeance de notre propre volonté : l’État dans sa munificence a foncé dedans et les vielles gens déclareront leurs revenus virtuellement : ils n’ont pas d’ordinateur ? pas de logiciel adapté ? pas de connexion internet ? Allez… non mais n’importe quoi – on peut dérouler le fil avec france télécom devenu orange par la grâce d’un commissaire européen t’sais (celui qui s’est fait cambrioler au début de l’année, son valet lui-même dormaient dans l’appartement) celui qui a mis au point les radars sur les routes au ministère des finances quand il en était ministre – bon il avait aussi une boite qui fabriquait lesdits radars, mais si on ne s’entraide pas) : lui a succédé le fameux Lombard t’sais le mec de la mode qui fait appel après son procés, lequel brave homme a été suivi par le dircab de la ministre des finances de l’époque, (elle est à la banque centrale européenne, après le fonds monétaire international, laisse) non, ces linéaments ne servent à rien… : essaye d’appeler au téléphone ce « fournisseur d’accès à l’internet », tu m’en diras des nouvelles – on n’a pas le droit de cracher dans la soupe ni de mordre la main qui nous nourrit (nous nourrit-elle seulement ? on ne va pas entrer dans de tels détails, l’heure est à l’union sacrée – quelle santé !) – prendre conscience de ce qui se joue et de ce qui est mis à l’ordre du jour (deux mois d’état d’urgence sanitaire soixante heures par semaine pour le prolo, parce qu’on ne peut pas engager des gens, tu comprends bien, qui peut savoir s’ils ne sont pas infectés et ne vont pas propager cette horreur, ce bazar ?) – bad spirit c’est vrai – je n’édulcore rien en ce qui concerne la banque, ce n’est pas non plus ce qui nous occupe – le travail, c’est la santé chantait Henri Salvador (le Sauveur)