je ne me souviens plus pourtant ce n’était que voilà, peut-être, dix jours, il y avait un signalement sur ce réseau social de maçon, de la part de François Bon, lequel indiquait qu’une de ses relations de la villa Médicis des années quatre vingts si je me souviens quand même avait posté quelque chose sur un train et la ville de Valentine (ou alors j’ai inventé cette proximité). Le problème avec le rédacteur solitaire, c’est qu’il est curieux (il pose ici ce billet, tout autant pourrait-il le mettre ailleurs, chez lui ou dans un autre lieu encore – il est curieux, et réflexif). Je me suis dit tant qu’à faire, je vais aller voir – il y a sur le bord de cette route (ça se passe aux Etats) une wtf succursale d’un faiseur de prêt-à-porter (en plein désert : OSEF).
Valentine, Texas USA. Le rédacteur curieux et réflexif est aussi presque tout autant superstitieux : à peine arrivée sur les lieux, voilà ce qu’il trouve

un peu comme à la bibliothèque de New-York, ces deux félins en gardent l’entrée (#323)

zoom arrière, les grands espaces ?

continuons : sur cette route (numéro 90) en traverse cette petite contrée de Valentine (pour ne pas dire trou hein, comprends-moi bien) pour arriver en sortie (ou en entrée tout dépend, évidemment) à cette station service (ici photographiée en 2008)

et là en 2013 (à gauche, le drapeau (american stars and bars – les étoiles et les barres étazuniennes) flotte sur le bureau de poste)

augmenté donc d’une espèce de toiture en zinc (le drapeau flotte dans le vent, donc ou n’est-il que faux, comme sur la Lune en 69 ?) rougi de peinture qu’on aperçoit ici, bord cadre à gauche en bas, pour donner quelques indications de la topographie du lieu

ah non, on voit rien, pardon, sinon que la ville est faite autour de la voie de chemin de fer : on descend pour aller voir, on tombe immédiatement sur ça

(il ne fait pas de doute que, comme l’indique à un moment le chanceux Eric Guillard dans son « Ordre du jour », le rédacteur a quelque velléités d’amusement d’enfant ainsi que l’ordure Goering en sa cave, je ne sais plus où – jte parle même pas du reste que trimbale avec lui le train et ses wagons à bestiaux) (je mets un lien quand même) : ici le spécimen dispose de deux locomotives comme on voit, mais la longueur du bidule se borne à quelques 21 wagons

ce qui fait, malgré tout, assez peu

ça se termine là

avec ces deux tapis roulant à épandre (je suppose) le ballast.
Trop petit : il tient dans une image
 : s’il fait deux cents mètres de long, c’est le bout du monde…
: s’il fait deux cents mètres de long, c’est le bout du monde…
J’ai donc cherché un moment encore (car, de plus, je suis patient et je sais attendre) parcourant cette voie de chemin de fer des Etats-Unis d’Amérique (je pensais à Rockfeller, aux coolies et autres malheureux mortels dévolus à la construction d’un tel ouvrage) ici une vue pour appréhender et le désert et la route qui longe la voie ferrée

des paysages sans fin, immenses, la frontière de l’ouest

en bas, Valentine, au presque centre Van Horn, et vers le haut Sierra Bianca : entre les deux villes peut-être quatre vingt kilomètres, on approche de Sierra Blanca

enfin il faut s’approcher encore

et distinguer le bourg de Sierra Bianca, en bas, à droite, la route désormais numéro 10 qui longe la voie de chemin de fer – en haut, le mont Sierra Bianca ici capturé par une certaine Cecilia Marchan dit le robot

recadré par le rédacteur) on distingue peut-être les fils du télégraphe qui bordent aussi cette voie de chemin de fer, qui lors du léger infléchissement vers le nord fait découvrir ceci

un peu au delà de Etholen

on ne le distingue pas encore, mais sur celle-ci

il commence à apparaître (il ne tiendra pas dans une image, il compte plus de cent wagons, ce qui en fait un bazar de plus de deux kilomètres de long)

devant : trois locomotives tractent

à l’arrière une quatrième qui pousse

assez loin, il faut le reconnaître (ou alors est-ce l’inverse, trois qui poussent une qui tire ?)(ça m’étonnerait jte dirai) et entre ces moteurs, des wagons

des wagons

des wagons (on remonte)

encore (y’en a 103…)

et encore

pour finir

et sur le croisement de la route qu’on voit en haut de l’image précédente, celle d’un certain C. Marquez du train qui passe là

disproportionné, too big to fail ? Deux chauffeurs ? (la Bête humaine…) (Jean Renoir, 1938 – ou Milou, 1890). Je me disais, voyant le film d’Otto Preminger « Tempête à Washington » (Advise and consent, 1962) que j’étais plus habitué aux marques et objets étazuniens, et que de les voir en film ne m’inquiétait pas tellement (je les reconnais) mais qu’en revanche ceux d’autres pays… Le cinéma, les trains, les Etats-Unis… (l’histoire écrite par les vainqueurs, sans doute)
addenda : retrouvé, c’était à Marfa (au sud de Valentine, quarante bornes peut-être, Quebec puis Ryan par la 90); et l’artiste c’est François Delbecques)
 Longuement aussi à ceux de Good Year (ici aussi, édifiante constatation : mais des suicides des employés, qui en a quelque chose à faire ? T’en souvient-il de ce charmant dirigeant manager formidable en tous points qui parlait à ce sujet d’une mode dans l’entreprise qu’il avait l’honneur de diriger – lean management, quand tu les tiens… – c’était il n’y a pas dix ans). Et aussi à ceux de Lip, et à ceux de ce magnifique « L’usine de rien ».
Longuement aussi à ceux de Good Year (ici aussi, édifiante constatation : mais des suicides des employés, qui en a quelque chose à faire ? T’en souvient-il de ce charmant dirigeant manager formidable en tous points qui parlait à ce sujet d’une mode dans l’entreprise qu’il avait l’honneur de diriger – lean management, quand tu les tiens… – c’était il n’y a pas dix ans). Et aussi à ceux de Lip, et à ceux de ce magnifique « L’usine de rien ».




 Hors champ, lorsque dans l’histoire cette bête se blesse, pour garder sa liberté, il faudra l’achever. Et c’est cette mort même qui a servi de point de départ au film (The Rider, Chloé Zhao, 2017, présenté à Cannes en 2017 à la quinzaine des réalisateurs) et de moteur : l’allégorie qu’emploie le jeune cow-boy, cette plume qu’il porte sur son chapeau, sa vie elle-même qui ne vaut plus d’être vécue s’il ne peut plus jouer sa partie au rodéo.
Hors champ, lorsque dans l’histoire cette bête se blesse, pour garder sa liberté, il faudra l’achever. Et c’est cette mort même qui a servi de point de départ au film (The Rider, Chloé Zhao, 2017, présenté à Cannes en 2017 à la quinzaine des réalisateurs) et de moteur : l’allégorie qu’emploie le jeune cow-boy, cette plume qu’il porte sur son chapeau, sa vie elle-même qui ne vaut plus d’être vécue s’il ne peut plus jouer sa partie au rodéo.

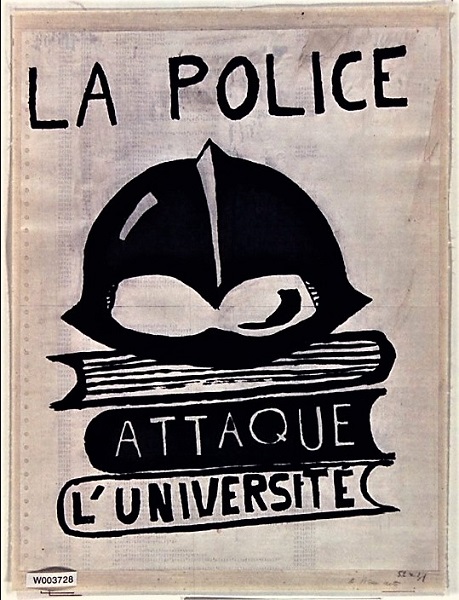





 sans doute ourdit-il un plan dont il ne confie pas la teneur à sa femme. Simplement : il se bat
sans doute ourdit-il un plan dont il ne confie pas la teneur à sa femme. Simplement : il se bat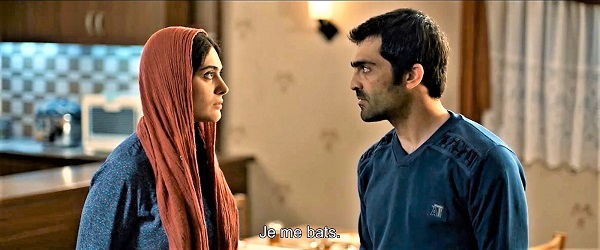 Seul. Contre tous, il vend son auto, paye, tente de surnager : non. Sa maison brûle…
Seul. Contre tous, il vend son auto, paye, tente de surnager : non. Sa maison brûle… On se souvient de l’avant-dernier plan du film de Tarkovski « Sacrifice » cette merveille. Oui, on met le feu à sa maison (il a fait partir sa femme et son enfant chez son beau-frère, parce que se battre voilà le moteur). Il se bat
On se souvient de l’avant-dernier plan du film de Tarkovski « Sacrifice » cette merveille. Oui, on met le feu à sa maison (il a fait partir sa femme et son enfant chez son beau-frère, parce que se battre voilà le moteur). Il se bat
 Paysages magnifiques, villes et villages, villageois et vengeances, ce n’est pas qu’on ne le comprenne pas, simplement il est rattrapé par le reste du monde. Le film a obtenu le grand prix de la sélection « Un certain regard » à Cannes en 2017.
Paysages magnifiques, villes et villages, villageois et vengeances, ce n’est pas qu’on ne le comprenne pas, simplement il est rattrapé par le reste du monde. Le film a obtenu le grand prix de la sélection « Un certain regard » à Cannes en 2017.



















































 non, ça n’a rien à voir avec ces éclats de rire d’autres concurrents laissés en arrière (mais pourtant, quelle joie…!) restons calmes, pondérés et présentables
non, ça n’a rien à voir avec ces éclats de rire d’autres concurrents laissés en arrière (mais pourtant, quelle joie…!) restons calmes, pondérés et présentables









 (je veux dire l’image) (encore que pasto completo 10 euros non seulement ça rime mais en plus ce n’est pas trop onéreux) on mettra des italiques plus tard, on continue notre mise en ligne, toutes celles-ci sont en ville
(je veux dire l’image) (encore que pasto completo 10 euros non seulement ça rime mais en plus ce n’est pas trop onéreux) on mettra des italiques plus tard, on continue notre mise en ligne, toutes celles-ci sont en ville












