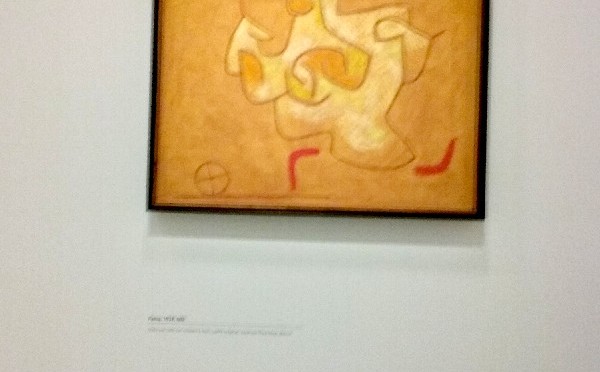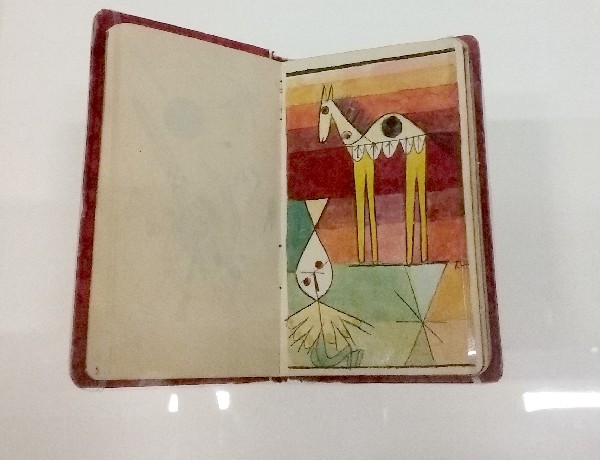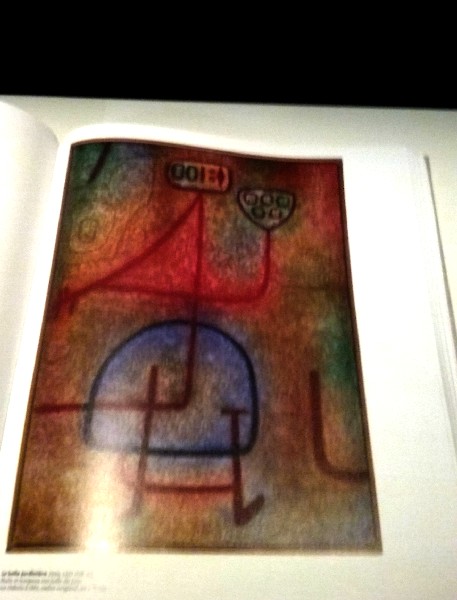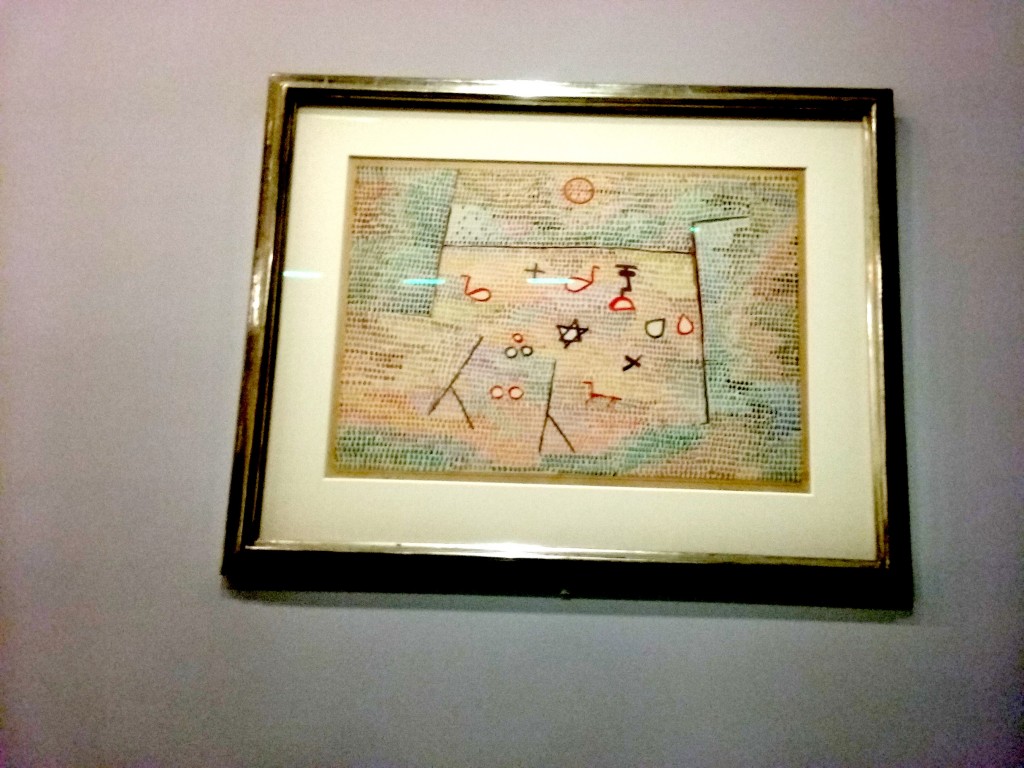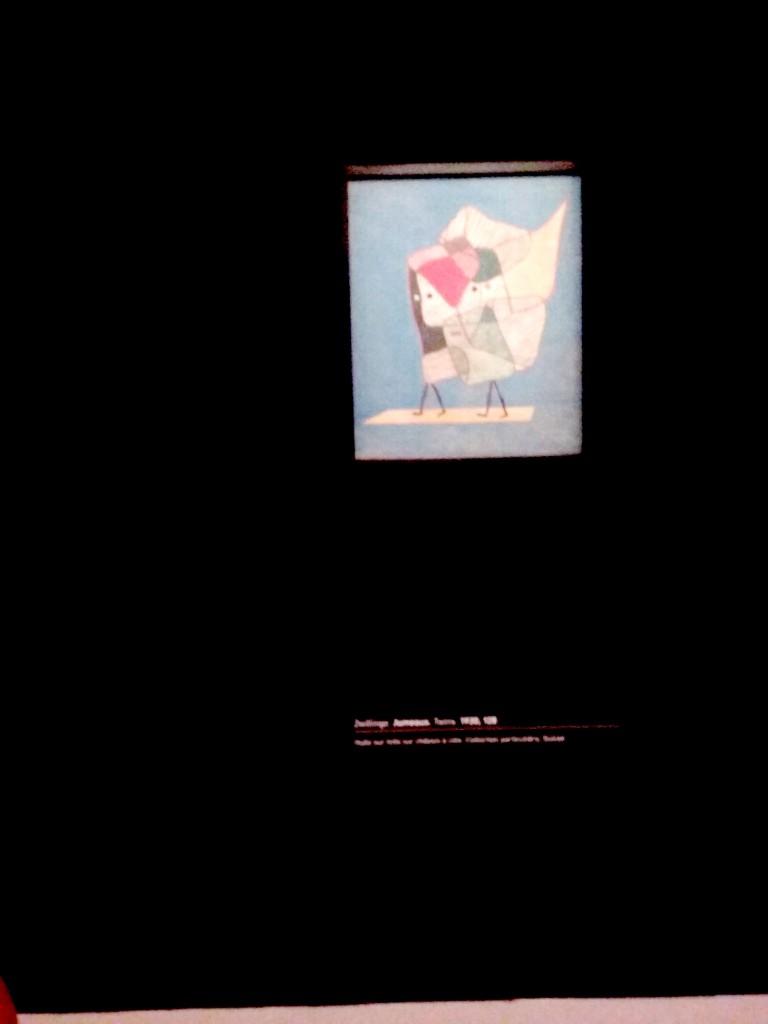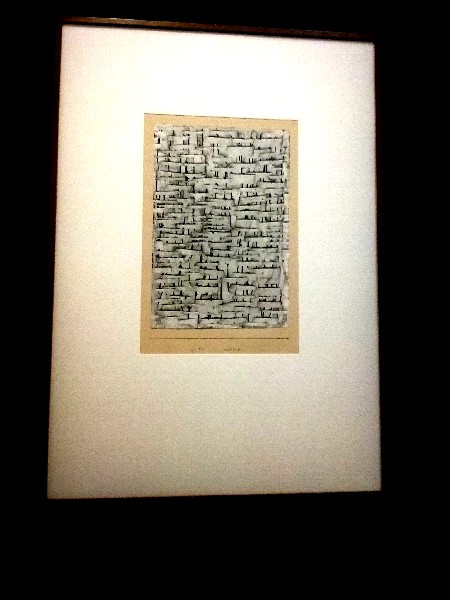non, la colère, non – même si ça servait à quelque chose, c’est impossible, c’est sûrement trop tard – mais on reste en prison – on regarde quand même les choses qui passent (les images sont des choses) – elles me rappellent ce que je suis, de quoi je suis fait – il y a eu cet entretien que j’ai écouté, avec Allain Leprest
c’est un chanteur, un poète aussi bien qui disait « une chanson, c’est cinquante pour cent les mains » – c’est plus que d’avoir quelque chose avec les chansons (ou avec la chanson) – je regardais aussi cet entretien de Jacques Higelin (gaffe : lien vers facebook) (merci à Laurent Peyronnet) au sujet de Léo Ferré – mais oui, l’âme – j’aime assez les chansons comme j’aime les images –
(des tonnes : requiem pour un fou) les stars et les espions –
là elle joue dans « madame la juge » (une ex-avocate qui devient juge – série de 4 ou 6 je ne sais plus épisodes télé fin du siècle dernier années soixante-dix – elle nous a quitté en 85; au Père Lachaise avec son Montand à côté d’elle)
je lis un truc sur Marguerite (un truc, c’est petit de dire ça) sa biographie par Laure Adler (un folio (3417) acheté 3 euros chez momox) – le Jouvet avec cette actrice Asie du sud-est, Foun Sen (l’épouse de Léo Joannon (dont on tait les frasques avec la Continental – on ne les oublie pas cependant ) que j’ai croisé(e) dans le « Oncle Dan » dont je rapporte l’index, la semaine prochaine ici même) (elle tient de le rôle de l’assistante du télépathe Winckler (ainsi que l’un des personnages de « La vie mode d’emploi » (Georges Perec, Paris Hachette, 1978) et pseudonyme vivant)
incarné par Erich von Stroheim – puis avec Jany Holt (laquelle est, si je ne m’abuse, l’une des grand-mères de l’auteur, Jean-Marie Périer) (ça se passe dans « L’Alibi » (Pierre Chenal, 1937) – ce ne sont que des images et tous ces gens sont morts (ça ne change rien, ils sont là) – une image du Joli Mai
de Chris Marker (1962-3) (lion d’or vénitien, on peut le regarder comme le « Chronique d’un été » (Jean Rouch et Edgar Morin, 1961) des images de ces années-là) – j’avance tu sais mais pour quoi en faire et vers où, je ne sais pas bien – je repose celles-ci (je les aime tant) : attendre l’autobus sur les hauts de Lisbonne (il en est des tas, des hauts de cette ville)
on ne le voit que mal, mais il est là – ici avec probablement sa femme
dans « Le tramway de la ligne 28 » (Denis Pasquier, chez l’auteur, 2020) – cette vie-là, dehors et riante – bien d’autres choses sans doute mais que j’oublie – il faudrait garder ces choses, les inscrire dans un album pour tenter de se rassurer sur son existence – et la leur –
on a presque oublié qu’on allait lire le journal en terrasse, café verre d’eau – ici le trottoir de la droite de la rue de Verneuil – et puis encore trois images
de ces nuages
plutôt merveilleux (du côté de l’Alaska)
sans doute reviens-je de (ou vais-je) loin pour ne pas regarder ce qui se passe ici et maintenant – cette honte et ce décharnement de l’hôpital pour aboutir à celui de la sécurité sociale, les avancées dues à l’issue de deux guerres mondiales – la résistance, et son conseil national – poubelle de l’histoire capitaliste – se battre et mourir – la publicité et le marketing – l’ordure – j’en finis avec cette image rézosocio – on s’y rappelle souvent à votre bon souvenir (des images pour vous y aider, quelque chose de tellement beau (le souvenir) utilisé pour quelque chose d’abject –  (on peut remarquer le genre des photographes saisi par cette image) cette charmante Varda, M veste rouge fils (de Louis) et petit fils (d’Andrée) et l’artiste de rue JR (Cannes hors compétition, présentation de « Visages, villages » voilà non pas 2 mais 4 ans) (quoi qu’il puisse arriver, la publicité comme le marketing et leurs avatars (dont le rézosocio est le parangon immonde) (mais une immondice d’un organisme immonde devient-elle autre chose ?), quoi qu’il puisse en être de ces forces, rien n’attentera jamais à l’amour qu’on a pour ces gens)
(on peut remarquer le genre des photographes saisi par cette image) cette charmante Varda, M veste rouge fils (de Louis) et petit fils (d’Andrée) et l’artiste de rue JR (Cannes hors compétition, présentation de « Visages, villages » voilà non pas 2 mais 4 ans) (quoi qu’il puisse arriver, la publicité comme le marketing et leurs avatars (dont le rézosocio est le parangon immonde) (mais une immondice d’un organisme immonde devient-elle autre chose ?), quoi qu’il puisse en être de ces forces, rien n’attentera jamais à l’amour qu’on a pour ces gens)