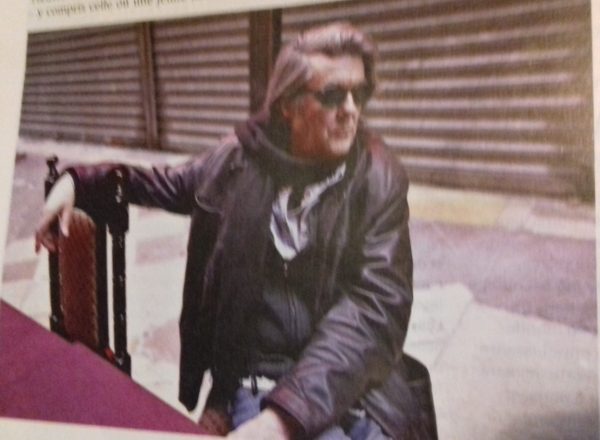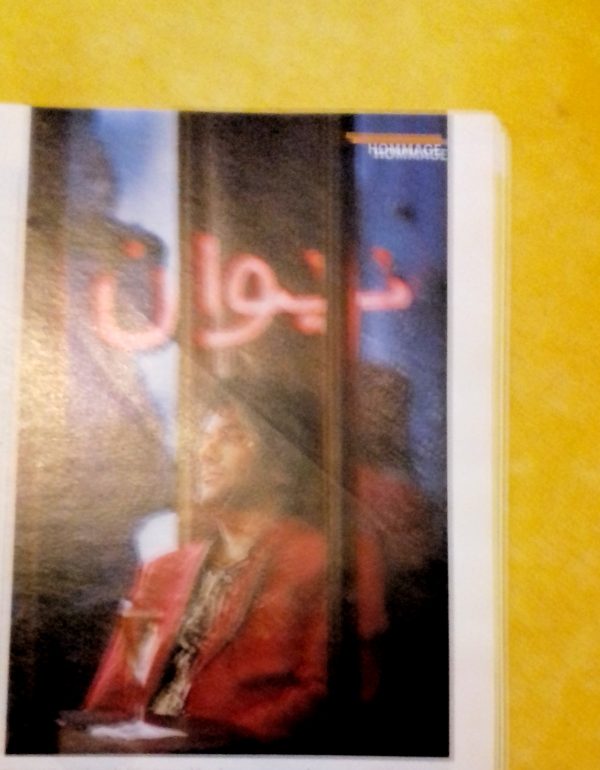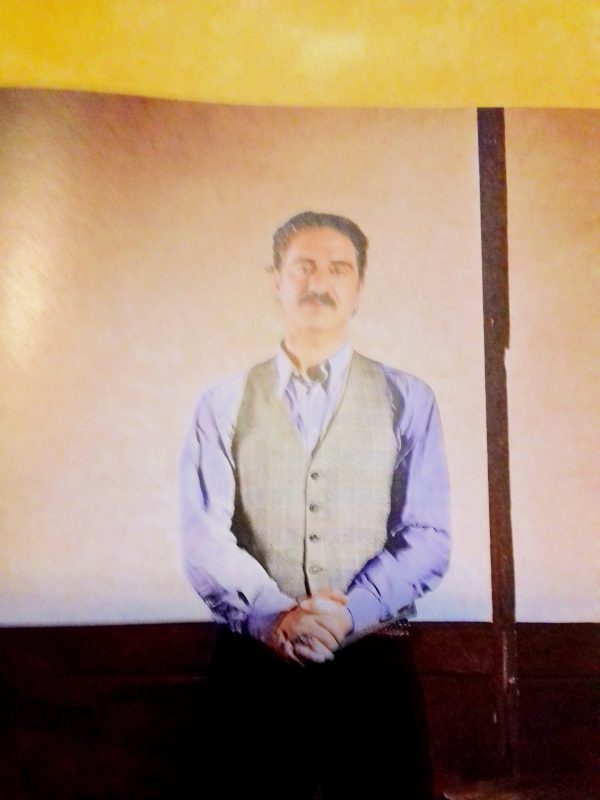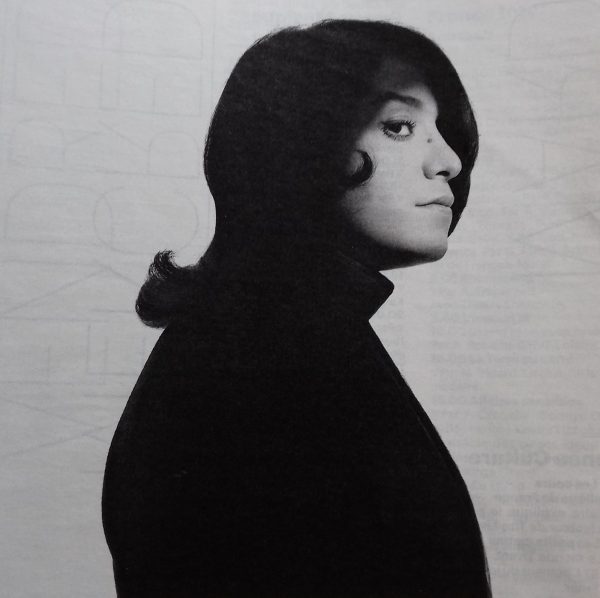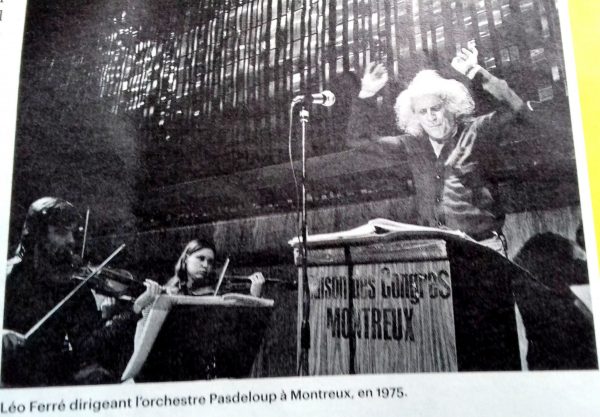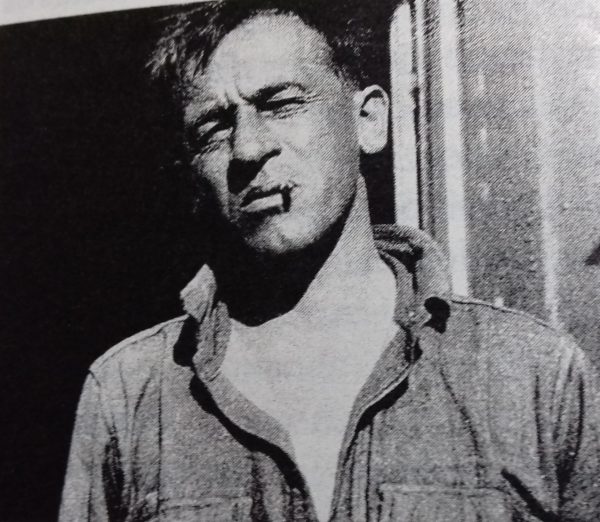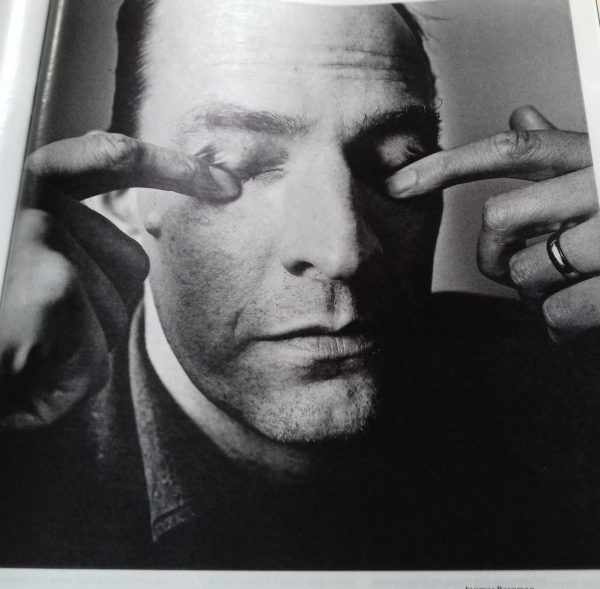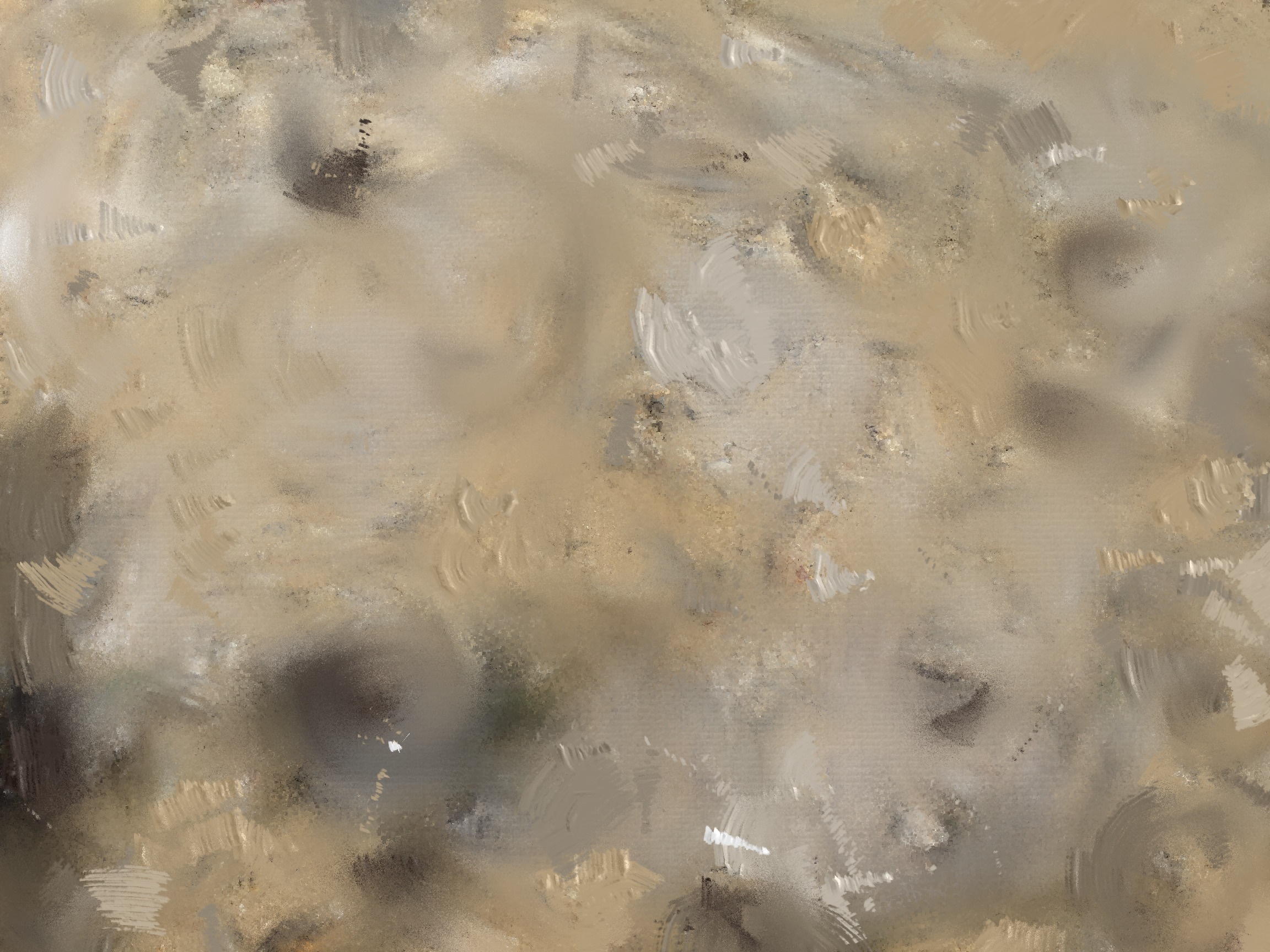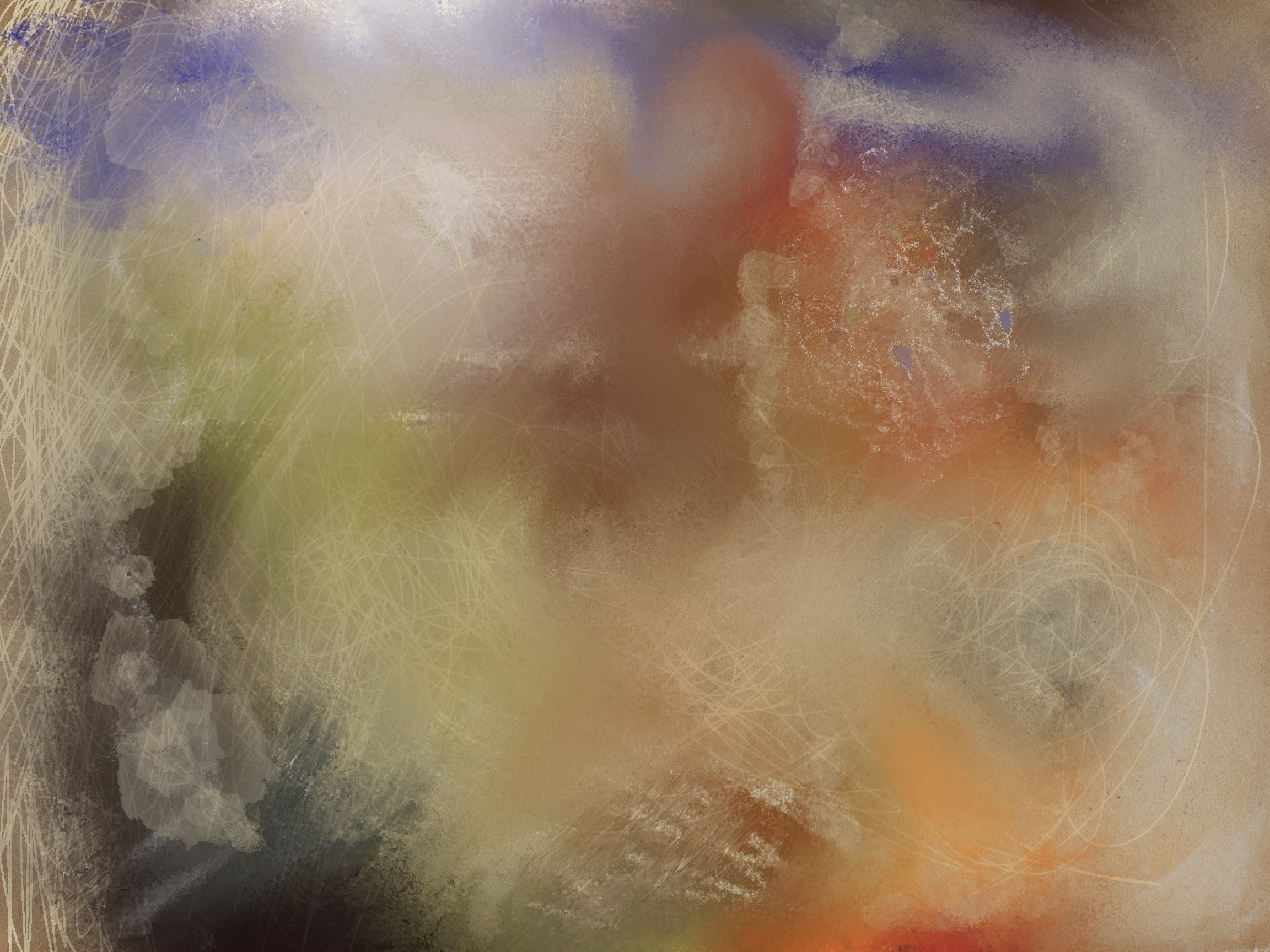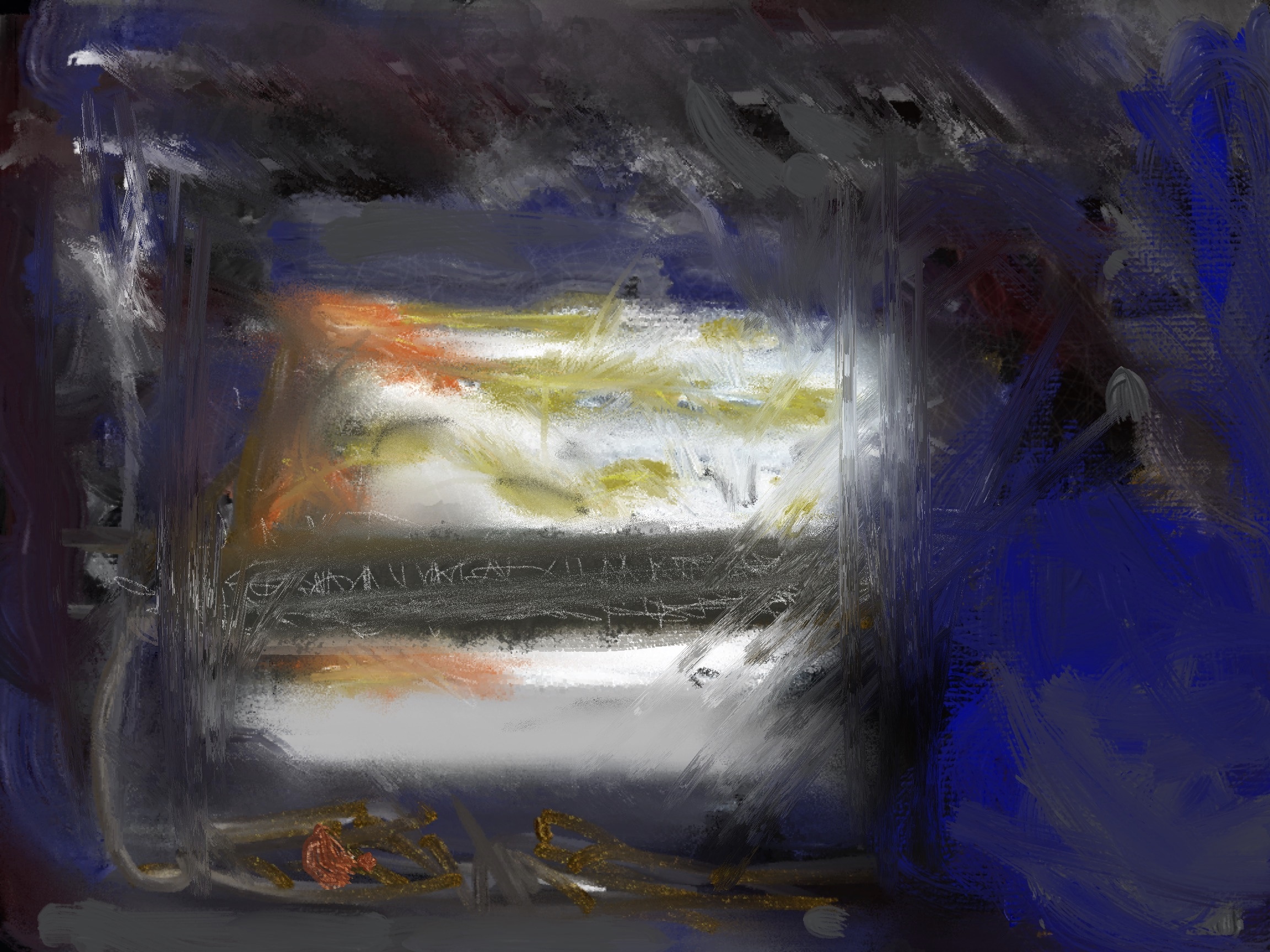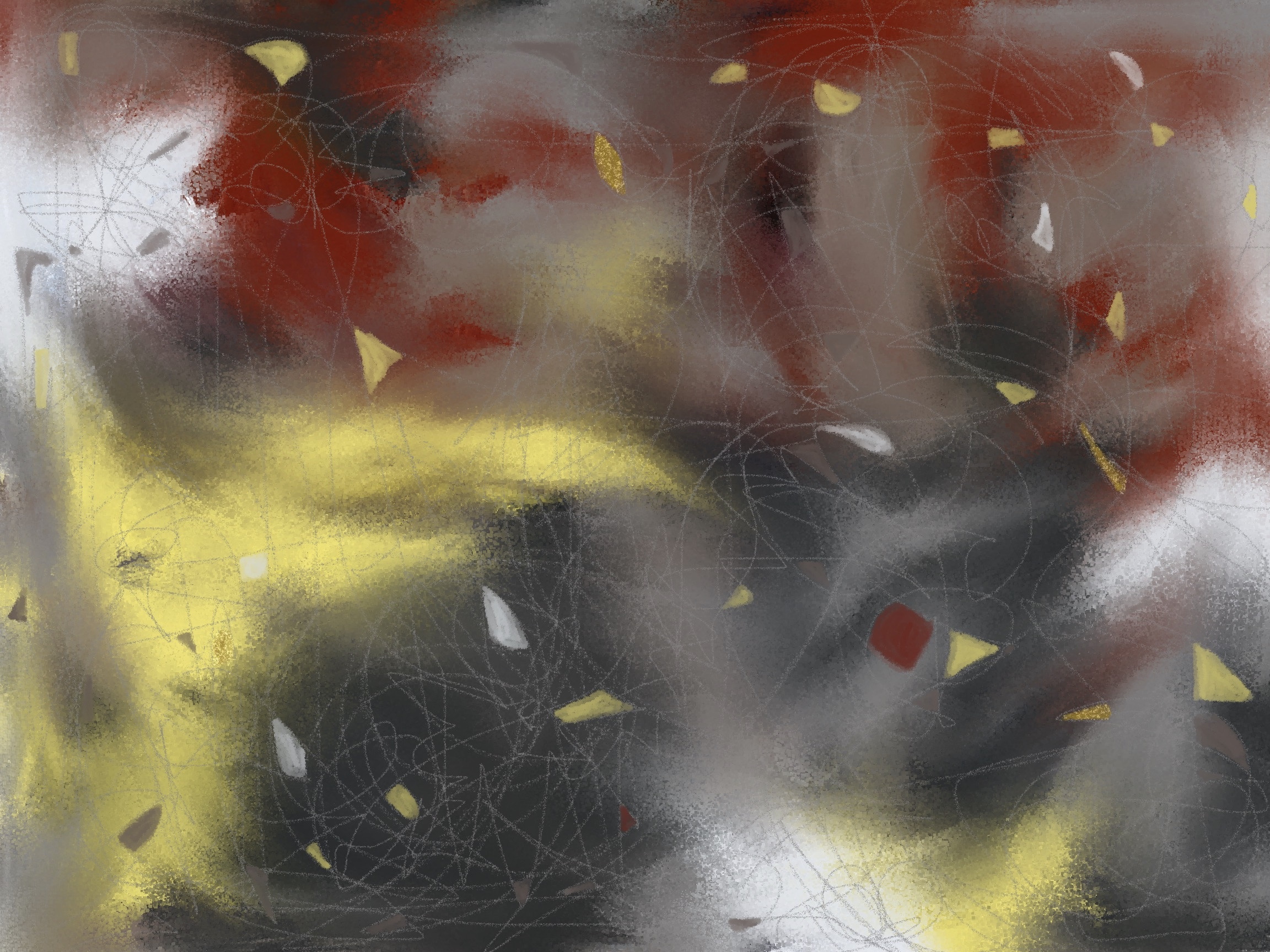Donc oui, c’est ce que je me suis dit, j’ai assisté à une bascule. J’étais dedans, et même active à basculer avec les autres, parce qu’on ne savait pas, on n’avait pas de recul, tu sais comme c’est, on vit des choses et les jours passent, on écope, on avise, on improvise avec les multiples pressions, et parfois on ne remarque rien.
Ça me rappelle cette vidéo : on te demande de compter des corps, je ne sais plus, des corps de basketteurs en pleine action je crois, tu dois compter les basketteurs ou bien compter le nombre de fois où ils se passent la balle et toi, tout le temps de la vidéo, tu comptes minutieusement ce qu’on t’a demandé de compter, tellement obnubilée par ce que tu additionnes que tu ne remarques pas qu’un lapin géant passe dans le champ, ou bien qu’un ours géant traverse le terrain, enfin des gens déguisés en mascottes de football américain évoluent là en plein milieu. C’est après coup que tu le réalises, parce que quelqu’un te dis Tu as vu le lapin géant ? tu te dis Oh la belle entourloupe ! et dans le meilleur des cas tu souris de cette bonne plaisanterie que t’a joué ton cerveau. S’obnubiler ça rend aveugle, c’est le principe des idées fixes, et c’est peut-être ce qui provoque la naissance des névroses, bref, tout ça pour te dire que j’ai été obnubilée, et ça a commencé pendant les années 80, je n’ai rien vu, je n’ai pas vu le lapin géant.
Au début tout se passait bien. On arrivait le matin avec deux ou trois idées, eux ils étaient entre vingt et vingt-cinq et ils avaient trois ans, ou quatre, enfin pas plus. On réagissait au contact. Il fallait être réactif. Être aux aguets. Se demander ce qui se passait. Se demander ce qu’ils et elles avaient en tête. Qu’est-ce qui les triturait. Et nous on s’engouffrait dedans. Par exemple — je dis comme ça me vient, ou plutôt comme je m’en souviens— une petite racontait qu’elle était allée à l’église, à un mariage peut-être, je ne sais plus, elle avait environ trois ans et ce qu’elle disait c’était les cloches, ce bruit, les cloches qui sonnent, elle avait trouvé ça épatant. À cet endroit, l’endroit dont je parle, l’église était récente, équipée d’un clocher moderne, du béton épuré, une sorte de tour ouverte sur le ciel par trois grandes arches traversantes, avec dans chacune d’elle une cloche. Alors, en se partageant cette histoire de cloches on l’avait dessinée, et on avait manipulé des mots, clocher, arche, cloche, des verbes, sonner, résonner, etc, et on avait aussi compté, vu qu’elles étaient au nombre de trois ces cloches, et en dessinant le bâtiment on s’était fait la remarque que la plus petite cloche était en haut et la plus grosse en bas, enfin on comparait les tailles, et chacun pouvait dessiner son clocher — évidemment l’église se trouvait à côté de l’école, tu sais comme c’est dans les villages, tous les minots passaient devant — on avait discuté, discuté, comparé, raconté, décrit, déroulé l’expérience de chacun dans le partage, on partageait un point de repère dans l’espace géographique tout près de nous, et finalement on formait tous un groupe. Après, chacun faisait comme il voulait, je veux dire les instits. On pouvait poursuivre l’histoire avec le geste de dessiner des arches, et comme ça rapprochait du geste de l’écriture des m, des n. On pouvait peindre le clocher en aplats de couleurs et sur la feuille placer le haut le bas. On inventait aussi. On ajoutait des gens, c’était franchement des gens même si pour la plupart on aurait dit des haricots à tentacules, bref, tu vois on vivait une expérience commune, chacun avec ses possibilités dans une façon de faire, poussé par une petite tape d’énergie active.
En fait, nous, en tant qu’adultes, notre premier boulot c’était d’être attentif. Un sacré job. Et rebondir, toujours. Tirer des lignes, tracer des ponts entre un vécu et une histoire de petit ours brun et les paroles d’une chanson et un tableau d’August Macke. On ne chômait pas à créer du commun. On rigolait aussi. On vivait en fait, on vivait chaque moment comme un moment possible fertile. Un moment d’expériences nutritives, passionnantes.
Donc ça c’était le contrat quand je suis arrivée, et je le faisais car c’était mon boulot bien sûr, mais aussi parce que je me sentais servir à quelque chose, entre l’affection, l’interaction, l’aide, comme quand tu tiens la main au petit qui apprend à marcher (tu ne fais pas ça en tant qu’agent comptable).
Figure-toi que je suis partie. J’ai bien fermé la porte sur tout ça. Je suis partie à cause du pronom relatif. Enfin, c’est une façon de dire. Ce qui a fait que j’ai décidé de partir commence là, avec le pronom relatif.
On nous a dit Il faut repérer celles et ceux des petits de trois ans qui utilisent à bon escient le pronom relatif. Comme ça on allait mettre au jour nettement celles et ceux qui ne l’utilisaient pas. Pour pouvoir après leur apprendre, on nous a dit. Sur le coup on n’a pas réagi. On ne s’est pas dit Ok Maurice, je te fais le topo, le petit qui entend à la maison le pronom relatif à bon escient bien comme il faut, eh ben il a un coup d’avance. Déjà on était inégaux. Ensuite il fallait faire en sorte, nous devions faire en sorte, de rééquilibrer ce bazar. Avec nos petits muscles. Mais on verrait plus tard, avant tout il fallait contrôler. Et maintenant, dans les années 90, ils n’étaient plus vingt-cinq, ils étaient plutôt trente, et parfois plus. On les mettait dans une situation forcée où le pronom relatif devenait obligatoire, avec un jeu de cartes à jouer par exemple (« dans la famille des chiens, je voudrais celui dont le poil est blanc »). Je me marre parce j’entends à la radio quelquefois des gens extrêmement bien élevés qui le sucrent ces jours-ci, ce pronom relatif, parce qu’à l’oral c’est ce qui se passe, moi aussi à l’oral je sucre parfois les dont. Donc, pendant qu’on contrôlait les dont, existants ou inexistants, on faisait des croix sur des pages, pour bien prouver qu’on n’était pas en train de rêvasser, acquis, non acquis, on cochait. Pendant ce temps-là les cloches sonnaient, un petit avait besoin de raconter sa grand-mère parce que pour lui c’était un événement, une petite avait besoin de raconter la jambe cassée du frère, parce que pour elle c’était un événement, et ç’aurait pu être partagé, être dit en écho à d’autres grand-mères ou d’autres jambes cassées, les amours, les bobos et les hôpitaux, la vie donc, la petite vie comme elle nous croque ou comme elle nous enchante, mais nous on disait Non. On disait Pas le moment. On disait Pas le temps, avec nos stylos préparés à cocher l’existence des dont. On insistait : Alors, et cette carte avec le chien dont le poil est blanc ?
On a commencé à ce moment-là à répéter très souvent, Non, Pas maintenant, On n’a pas le temps. C’était vrai qu’on n’avait pas le temps, le contrôle des dont étant exponentiel, car tu te doutes bien qu’il n’y avait pas que lui à contrôler, tout ce qui sortait des bouches, des mains, pouvant servir à établir des constats et données statistiques.
Du coup, comme je n’avais aucun recul et que, comme mes collègues j’avais toujours été une élève bien obéissante, j’ai contrôlé, les qui, les afin que, l’inversion du sujet quand on pose une question et la numération, la maitrise de l’outils scripteur, le repérage dans l’espace d’un quadrillage, tout ça à l’aide de supports étudiés, des supports performants, sans rapport avec rien de ce qu’on avait à se dire de la veille, sans rapport avec rien qui tenait du partage d’expériences vécues ou d’apprendre à marcher affectueusement, et on a commencé à aller au boulot avec l’attaché-case rempli d’exercices pertinents, parce qu’on était des bons élèves, tous et toutes bien obéissants. Comme ça, lorsqu’il fallait venir remplacer une absence en passant d’une école à une autre, ou d’un niveau à l’autre, peut importait s’ils avaient trois ans ou bien quatre, s’ils vivaient en cambrousse ou près d’un cinéma, nous on sortait nos fiches parfaitement adaptées à l’activité de contrôle. Ça fait peur quand je regarde avec mes yeux de maintenant, cette bascule entre les années 80 et les années 90. Pendant qu’on s’obnubilait à contrôler, on oubliait d’accompagner, on ne voyait pas passer les mascottes géantes de football américain, elles auraient pu s’asseoir sur nos genoux on ne voyait rien. On ne pouvait pas réparer les paroles manquantes, pas le temps, on ne pouvait pas réparer l’attention aux petits détails qui font le quotidien du vivre, pas le temps.
Bon, tu vas penser que c’est périphérique ce que je raconte, que c’est mettre l’accent sur une façon de voir, de faire, et que quand on regarde bien c’est mieux d’analyser en termes techniques, que c’est un signe de progrès, même quand il s’agit d’enfants très petits, si petits (dont l’âge pourrait tout aussi bien se compter en mois, c’est quand même fou, pas le temps, pas le temps).
Tu as sans doute raison. Je parle comme une vieille de cette vieille bascule. Ma vision d’après-coup est sûrement partielle, irréaliste, teintée de nostalgie, un peu ‘c’était l’bon’temps’.
Je ne saurais pas dire pourquoi j’ai repensé à tout ça ce matin. Pourquoi j’ai eu envie de venir en parler ici, dans la maison[s]témoin. J’ai eu l’idée pendant que je remplissais ce papier et que je cochais la case, je me suis dit en tant que bonne élève Je vais le faire au cas où il y aurait un contrôle, tu sais, ce papier à remplir pour acheter le pain.