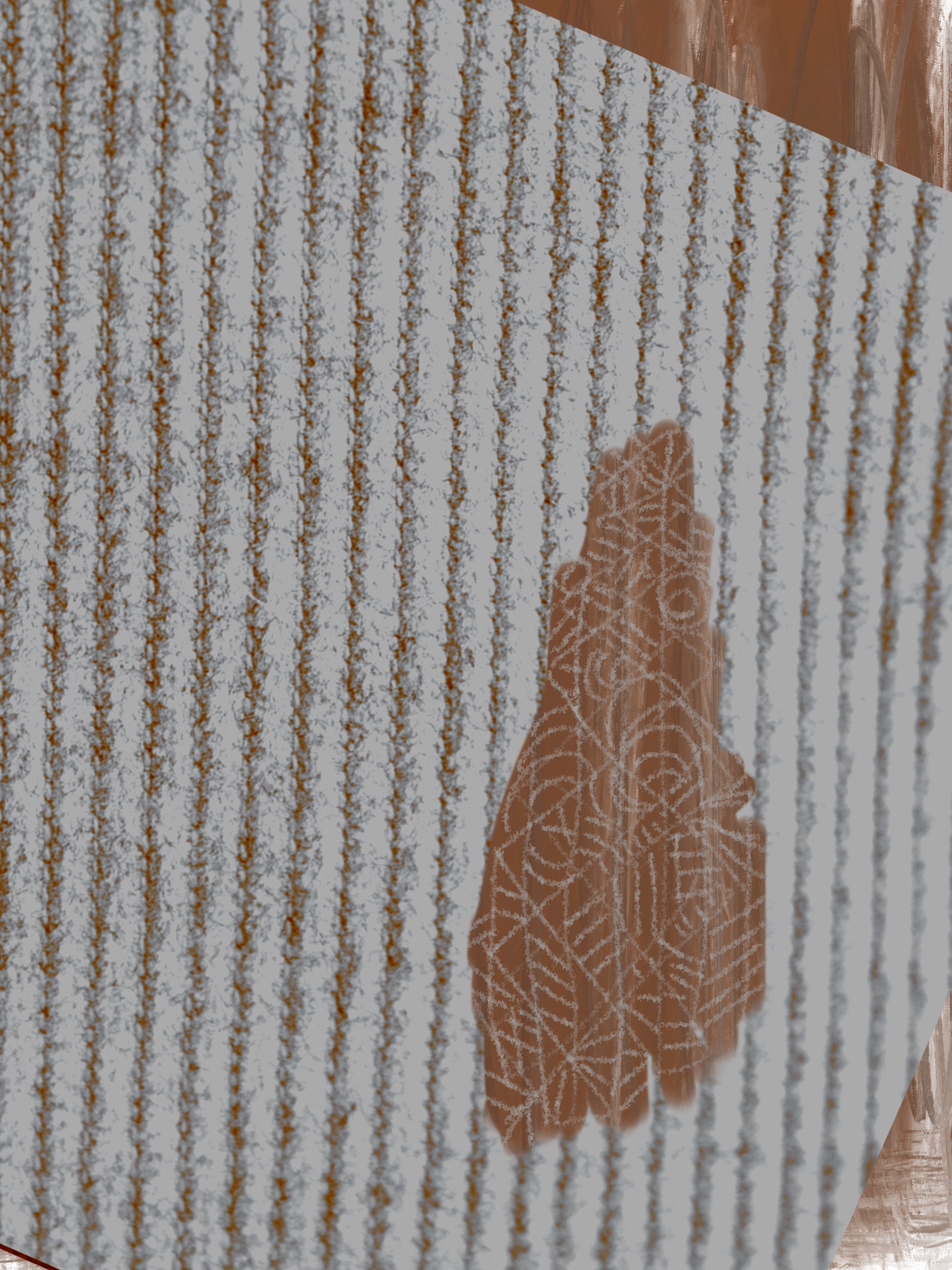.
.
.
Comme je suis lente d’esprit je n’avais rien compris au verbe habiter. Par exemple je n’ai jamais pensé qu’un architecte (pas la peine de tenter le une car ça date des années 50 ou 60) avait dessiné ma maison d’enfance, encore que non, il n’avait pas dessiné ma maison d’enfance mais proposé ses plans à l’usine, propriétaire du terrain autour d’elle, et désireuse d’y installer plusieurs logements de façon à ce que les ouvriers arrivent plus vite au turbin le matin et restent toujours à portée de voix.
J’avais bien compris que ma maison d’enfance appartenait à l’usine, que c’était presque une petite succursale, comme les salles de repos avec table de ping-pong pour booster la productivité des employés, espaces bien-être, et celle-ci accueillait la famille sur un temps plus long que celui de la pause, autorisait les employés à y manger à y dormir à y tomber malade à y construire une maquette de bateau et projeter des diapositives sur un écran qui une fois déroulé sentait la poupée neuve, à somnoler devant L’Homme de fer, autorisant aussi les femmes des employés à parcourir le lieu un chiffon à la main, les fils des employés à tailler leurs crayons jusqu’à ne plus pouvoir, les filles des employés à se gratter la tête, à être lente, et à ne pas tout comprendre comme maintenant.
Mais je n’avais jamais pensé qu’il y avait eu un appel d’offres pour produire ces logements (trois maisons pour les chefs d’atelier, un bâtiment sur trois étages avec chambres, douches et wc collectifs sur le palier pour les manœuvres bizarrement tous dotés d’un prénom algérien).
Parfois je regarde des reportages extrêmement bien documentés sur les prouesses architecturales. Par exemple, une bibliothèque en Allemagne je crois, une construction sur pilotis, avec un espace vert dessous, et les colonnes qui supportent l’édifice abritent les ascenseurs, et parce c’est un architecte vraiment très inventif on débouche sur une salle qu’on ne tarde pas à comparer à une cathédrale de verre à cause de la vue en hauteur sur tout un paysage boisé, vue imprenable qu’accentue un sol en pente légère, un plancher de bois exotique qu’une douce inclinaison sublime, ainsi le public se déplace-t-il majestueusement entre les livres, exceptés les personnes en fauteuils roulants trop durs à pousser, à tirer, manœuvrer étant donné la présence inattendue et accentuée par la déclivité de ce qu’on nomme gravité universelle (mais les architectes inventifs doivent-ils accepter d’être soumis à ce genre de détails ?).
L’architecte de ma maison d’enfance a dû être inventif autrement, en restant surtout attentif au rapport qualité prix. Sous-sol sous toute la surface pour contenir l’humidité du sol et ralentir la progression de celle-ci à l’étage. Plain-pied, donc un seul escalier. Une porte d’entrée (c’est le minimum), à droite le mur qui délimite une chambre, à gauche les chiottes et la salle de bain imbriquées façon Tetris, puis la cuisine, c’est-à-dire un couloir, on ne peut pas s’y croiser, on œuvre en crabe, déplacement latéral, ensuite une salle qui réunie toute la largeur ensuite redivisée en deux chambres pour les enfants, le tout sous toit en pente orienté vers rien. La prouesse économique ne s’emberlificote pas de luxes comme la vue. Une drôle de chose, la vue. C’est volatile, ça se limite à ce que captent deux yeux dans leurs cavités orbitales. Ça n’a pas de prix, et comme tout ce qui n’a pas de prix, ça se paye. Je n’avais jamais pensé à ça. Que ce qu’on voit est social. Je n’avais pas pensé que plus c’est haut, et plus c’est vaste, et plus c’est harmonieux, et plus tu as des chances de manger de Fines ravioles potagères aux saveurs d’Automne, un Gratin d’oignons doux des Cévennes à la poire fondante, des Coquilles Saint Jacques de Fécamp à la truffe Uncinatum. Et plus ta vue est basse et rétrécie, plus tu regardes au ras du sol, plus tu risques d’avoir une espérance de vie de quarante, cinquante ans, de te déplacer d’une rue à une autre, pas plus. Je n’avais jamais pensé que la hauteur à laquelle se promenait la tête répondait à une équation d’une force aussi implacable que celle de la gravité universelle. Je n’avais réellement rien compris au verbe habiter.
.
.