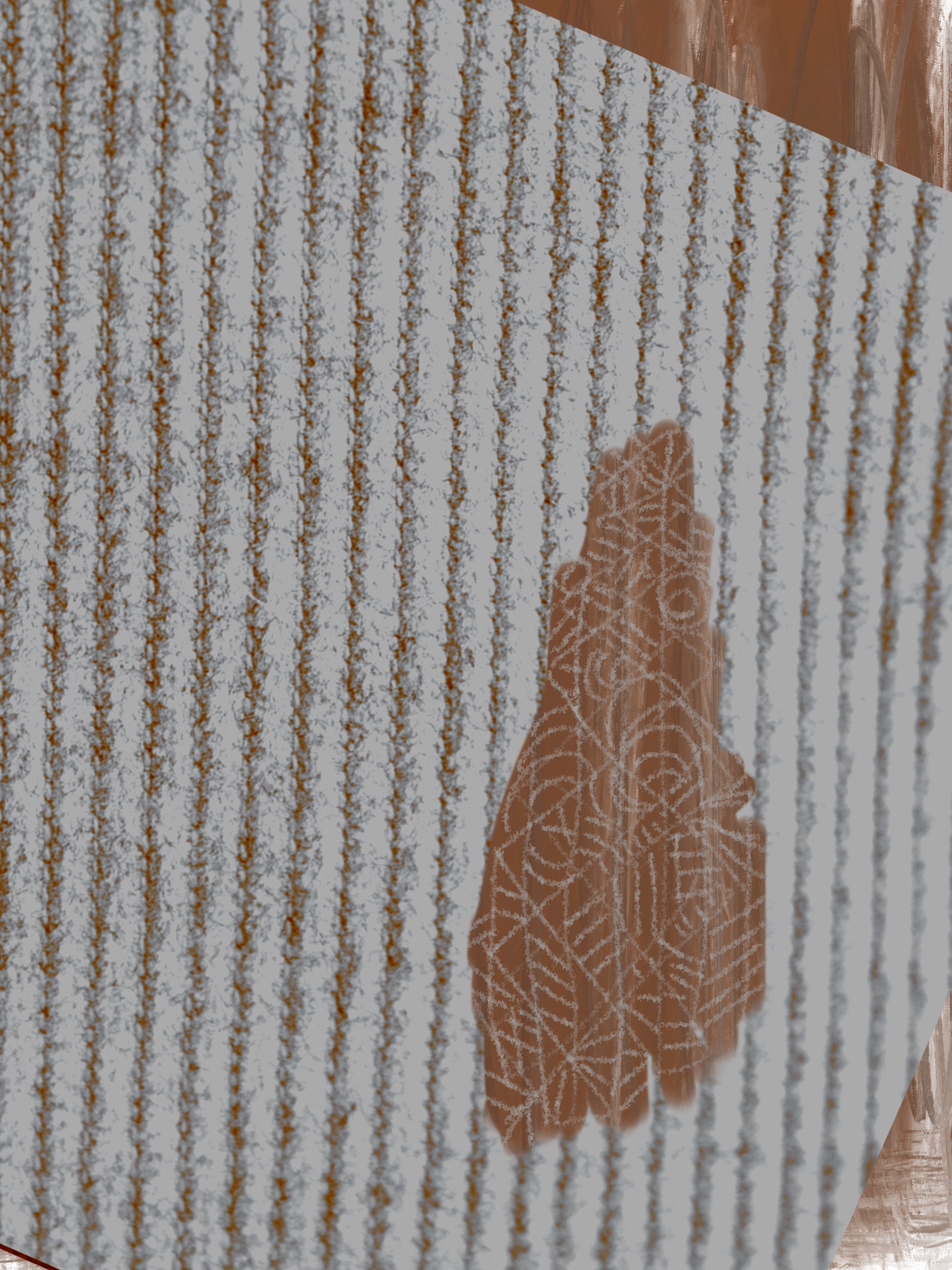Ma mère est ma maison.
Ma mère est faite de texte.
De textes.
C’est de plus en plus visible. C’est ce qui arrive avec les paysages en grands dangers, brossés par le vent, réduits à l’essentiel. Il ne reste plus que la ligne d’horizon et l’armature d’un tronc, un peu d’herbe, le bleu de la mer, c’est tout. Ce qui faisait foisonnement, la végétation dense, les ruelles, les fontaines de Trévise, les habitants et leurs déambulations, les points de vue panoramiques avec la rose des vents gravée sur une table d’orientation, les fêtes folkloriques, les processions de la fête de Saint Bernard, tout ce qui perdait le regard, les cigales la nuit, les nappes sur les tables dehors, froissées, éclairées par les lampadaires, les craintes d’orage et d’inondations, tout s’est enfui, recroquevillé, a disparu.
Il ne reste que quelques histoires droites, réduites au plus simple déclencheur. Ce sont toujours les mêmes. Il ne reste à ma mère que du texte. Elle écrit de moins en moins, et puis plus du tout. Des cartes de vœux, et je ne sais plus la dernière fois qu’elle a rempli un chèque. Ses lettres sont de plus en plus tremblantes, maintenant ce sont des chiffres qu’elle trace, elle fait ses comptes qui sont des contes, car elle ne s’appuie pas sur des données mathématiques. Je veille bien à ce qu’elle ait toujours des stylos à portée de main. Je lui ai acheté un cahier, c’est elle qui me l’a demandé, elle devrait y poser des additions, en tout cas c’est ce qu’elle désire, c’est l’outil de repérage auquel elle se raccroche.
J’ai longtemps cru que rien n’était plus éloigné de ma mère que le texte. Je disais :
elle parle pour ne rien dire
ce qu’elle dit n’a pas de sens
elle dit une chose et son contraire
elle parle pour parler
elle fait de l’air avec sa bouche et ses cordes vocales, c’est ce que j’ai longtemps cru.
En fait, elle est au-delà du texte, ce qu’on peut qualifier de prouesse.
Ou elle se trouve bien au-dessus du texte. Tout en haut. C’est lui qui la porte. Ce sont ses fictions qui la tiennent, soutiennent. Dans le paysage réduit à l’essentiel qu’elle est devenue, sa ligne d’horizon et son tronc sont ses fictions.
Elle me les répète sans arrêt.
On pourrait penser à un problème cognitif, à une maladie dégénérative, à une baisse des capacités logiques, à une perte de raisonnement, oui, beaucoup pourraient le penser, mais elle s’en fout. Elle répète. Elle ne se sent pas malade. Je vais bien, elle dit, et puis j’ai toute ma tête.
C’est le plus important.
Tu ne crois pas ?
Heureusement que j’ai toute ma tête.
C’est bien, je suis contente.
J’ai vendu la maison, je me suis bien débrouillée. J’ai été futée, heureusement.
(la maison a été vendue par obligation, ce n’est pas elle qui l’a voulu ou s’en est occupée, elle me montre le papier du notaire et m’explique qu’il vient d’arriver au courrier, c’est moi qui lui ai donné il y a six mois, nos histoires se chevauchent, parallèles qui ne se rencontreront pas, mais je veille bien à ce qu’elle ait toujours des stylos à sa disposition)
Plus son paysage se minimalise, plus j’augmente le mien, factice. J’ajoute et j’ajoute des pots sur la terrasse de cailloux cernée de murs.
Chaque matin je vais voir si le pied de houblon trouve une nouvelle direction avec sa tête de serpent. J’ai soif de lianes. Les clématites, les chèvrefeuilles et les tiges de cobée s’enroulent ensemble, selon la même chorégraphie indistincte. Les feuilles des capucines de Canaries s’élèvent, larges près du sol, réduites dans l’ascension. Le schisandra croule de fleurs discrètes qui se confondent avec des cerises, et son feuillage de soie cache un peu le géranium menthe dressé, debout. L’akébia n’en finit pas de faire de nouvelles volutes dans sa course avec les haricots géants d’Espagne. En Espagne, lorsque ma mère était enceinte de moi, elle a assisté aux processions, capuchons sombres, deux trous noirs pour les yeux, torches levées dans l’obscur, chants funèbres, et elle a eu peur. Ma mère est ma maison.
Étiquette : maison
pas de côté, épisode 17
.
.
.
Tant que tu ne vois pas tes limites, tu ne peux pas espérer les dépasser. Il y a cette discussion entre un professeur d’université blanc et James Baldwin dans I’m not your negro. Lui, le blanc, estime que nous sommes tous frères en humanité, au-delà de notre couleur de peau ou de nos croyances. Baldwin, le noir, sait que c’est un mythe. Il le sait dans sa chair, dans son expérience de vie, dans ce qu’il a vu et vécu. Il voit les limites, ce qui est le présupposé pour les dépasser. Le blanc prétend qu’elles n’existent pas. C’est pourquoi son raisonnement reste circonscrit à l’intérieur. C’est pourquoi rien ne change.
Dans une discussion avec un écrivain anthropologue où les questions posées le sont toutes par de jeunes hommes, le présupposé, qui est aussi le point de départ d’un livre de l’écrivain anthropologue, est le confinement. Pas « un » confinement, mais « le » confinement. C’est-à-dire, lorsqu’il l’explicite, celui d’intellectuels qui se sont trouvés reclus, empêchés de sortir de chez eux, forcés de remplir une attestation. On appelle ce confinement « le » confinement, le seul et unique, car il est écrit par ceux qui savent écrire. Y’a-t-il des livres sur un hôpital en temps de confinement, ou un hypermarché en temps de confinement, ou une épicerie, ou une station-service, ou un service de nettoyage en temps de confinement, des livres qui montreraient un autre confinement que celui qu’on a « tous » connu (dixit la discussion autour de l’écrivain anthropologue) ? C’est la limite. Tant que cette limite ne sera pas vue, donc que l’expérience de vie de soignants, d’éboueurs ou de caissières en temps de confinement comptera pour rien, tant que ce qui est vu et vécu par une partie de la population sera ignorée, il n’y aura pas de dépassements possibles, pas d’après, pas de demain. Tant que les discussions entre jeunes mâles blancs intellectuels leur sembleront admissibles et dignes de déboucher sur un échange d’idées, tant que de jeunes mâles blancs intellectuels trouveront pertinent de discuter entre eux d’une situation mythique car inopérante pour une partie de la population, il n’y aura pas de monde d’après. Tant que ces jeunes mâles blancs intellectuels ne s’arrêteront pas une seconde pour se poser quelques questions pratiques (Pourquoi avons-nous tous ici environ trente ans — Qu’est-ce qui fait que nous sommes tous blancs autour de cette table — Pourquoi n’y a-t-il pas de femmes parmi nous — Pourquoi discutons-nous entre membres d’une même classe sociale), demain ressemblera à hier.
Au moins, quand je parle de ma maison d’enfance ici, j’en connais la délimitation, qui ne s’exerce pas uniquement dans l’espace au sol occupé, ni dans l’espace sensoriel ou mémoriel évoqué, mais qui se trouve aussi ancrée dans mon âge, mon genre et ma classe sociale. Ça devrait servir à ça, écrire. À délimiter. Pour pouvoir ensuite, plus tard, grâce au luxe de ce temps disponible passé à y penser, tracer des portes qui puissent préfigurer une sortie éventuelle.
Tracer des zones, faire exister les zones, pour ensuite pouvoir les traverser, ce serait l’idée.
Au minimum, mettre en place la possibilité que cette traversée puisse avoir lieu (ce que fait Miró en quelque sorte).
Savoir d’où on parle pour mieux comprendre à qui.
Pour résumer, faire un pas de côté ?
.
.
épisode 4, velours côtelé
.
Ma maison d’enfance est un rectangle.
Ma maison d’enfance est petite.
Je marche dans ma maison d’enfance. Pour la traverser d’un bout à l’autre je fais 16 pas, du point B au point A.
Après 10 pas je tourne à gauche et je peux m’asseoir, marcher dans sa maison d’enfance est une chose spectaculaire, non pas spectaculaire, spéciale. Les volets sont ouverts.
Je m’assieds au bout de 10 pas, en travers, jambes pliées par-dessus l’accoudoir. Je lis. Ma mère avec l’aspirateur, tu vas brûler tes yeux, Alice et la statue qui parle.
Une nuit je rêve que glissée derrière le dos du fauteuil je me relève pour épier. Un sniper me vise et me touche juste entre les deux yeux, je suis morte. C’est la guerre sous le cerisier, des soldats se déplacent furtivement dans la rue. Ma tante est réfugiée dans le sous-sol, je vais la voir pour lui dire que je ne peux pas l’aider car je suis morte, dommage collatéral. L’armée nettoie les aires de mon rectangle proprement.
Je lis Alice et la statue qui parle,
je lis l’histoire d’une fille, je suis une fille,
je lis l’histoire d’une fille qui écoute ce que l’inanimé raconte
d’inattendu,
ce qui se cache derrière les bosquets, derrière les pages suivantes,
et j’en tire des conclusions sur ce qui peut se passer en vrai
derrière les rideaux écossais, 40 m de tissu / lot soldé à moins 60 %.
Les fenêtres de ma maison d’enfance sont recouvertes d’écossais, que je déteste, je déteste qu’on ne me laisse pas lire, je n’écris pas, c’est une chose inespérée, une activité qu’il ne m’est pas donné de connaître à l’heure où je fais mes 16 pas du point B au point A.
Mon corps est une écrevisse.
Mes oreilles sont des assiettes plates.
Mon ventre ne mange rien, il est complètement inutile, sauf pour tenir mes jambes articulées.
Mes yeux sont deux trous d’objectifs, le noir autour ne donne pas l’opportunité de retrouver ce qu’il y a face au fauteuil. Il n’y a pas de photo sur les murs de ma maison d’enfance. Mon mur actuel, situé à 346 km 3h52 mn sans circulation itinéraire avec péages, mon mur actuel est décoré de photos de filles et de femmes que je ne connais pas, photos en noir et blanc achetées sur une brocante parce que je les trouvais émouvantes et qu’elles me rappelaient quelque chose, qu’elles me reliaient à quelque chose, photos inanimées d’êtres inaccessibles qui ont parlé et que je ne sais pas lire mais que je veux écrire, statue qui parle, c’est simple.
Les images sont très compliquées.
Une fois que j’ai repensé aux rideaux écossais partout, c’est saturé, il faut que mes yeux s’en débarrassent pour mieux voir.
Je dis mon mur, je dis mes murs, je dis ma maison, mais il n’y a pas lieu de mettre des possessifs, les murs ne sont pas à ma moi, ma famille ne possède pas de murs ni parcs ni dépendances écuries granges etcétéra, je me souviens de ce propriétaire d’une location où j’habitais dont je savais que lui appartenaient plusieurs propriétés ici et là, villas, appartements, hangars, usines, qui disait au détour d’une phrase désinvolte posséder « quelque chose » en Normandie, quelque chose, violente formule.
Je ne possède pas quelque chose.
Quand je lis, avec mes jambes sur l’accoudoir, je ne vois rien, seulement le tissu du fauteuil, du velours côtelé marron que j’épluche consciencieusement. Maintenant on voit le chemin des coutures nues sous mes doigts. Ce qui a été épluché ne repousse pas, c’est bien dommage. Et maintenant sûrement je peins, je brode pour masquer le nu du tissu que j’ai abîmé, absolument.
Peut-être qu’en face du fauteuil il y a un ficus, ou ce genre de plantes vertes très courues dans les années 70. On passe du coton dessus, un mélange d’eau et de lait, pour nettoyer la poussière de l’usine et faire briller les feuilles. Mais ça ne pousse pas vraiment ces machins-là. Rien ne pousse dans ma maison d’enfance.
J’ai une planche de bois peinte en vert pour faire tableau d’école, je recopie le papier peint minutieusement. Si on ne m’arrête pas je vais recopier les motifs jusqu’à détestation du monde. La nuit je me mouille les cheveux puis j’ouvre les fenêtres et je respire à fond pour tomber malade. Je ne suis pas enrhumée aujourd’hui.
La distance qui me sépare de ma maison d’enfance est si grande que l’adresse sur google map n’est plus valable, je dois tricher en déplaçant le curseur.
Les paramètres mathématiques n’aident pas à la compréhension des forces qui nous maintiennent assis sur les fauteuils de l’outre-part (comme on dit autre part ou outre-mer, tu vois).
Je suis un skieur de fond, bras et jambes alternés avec force, geste sportif, pour franchir mes 16 pas il en faut de la sueur.
.
.
épisode 2, trompette d’or
Dans ma maison d’enfance – au sens large, je dis « maison » mais cette maison englobe le jardin, la rue, le territoire en arc de cercle contenu dans cette rue et dans la rue suivante en forme de virgule, tout un espace en plus d’un espace-temps délimité par je ne sais quoi, car il est difficile de pointer un début et une fin, le jour du commencement peut se perdre dans le flou et le jour du départ a parfois lieu sur place, ou bien on ne réalise que c’était lui que bien après –, il n’y a ni horizon ni ciel. Je crois que je n’ai pas assez de hauteur, je ne suis pas assez haute pour voir, même tout en haut de l’escalier qui mène à la porte d’entrée avec sa rambarde de fer, même sur la plus haute marche je ne vois pas l’horizon, seulement l’assemblage de façades, de murs, de toits, et la verdure d’un jardin éloigné où des enfants jouent (on dirait qu’il se passe quelque chose là-bas, peut-être que de là-bas on voit l’horizon). Il n’y a pas de ciel, car dans mes souvenirs il n’y a pas d’oiseaux. Un arbre, j’ai oublié son tronc, je ne vois que des feuilles grandes comme des mains, à éplucher, à creuser entre les nervures pour fabriquer de grandes araignées végétales. Le jardin est en pente. Ma maison d’enfance possède un toit oblique. Dedans, tout est d’équerre et c’est bien rassurant, ou bien très énervant. Parfois il y a des sons dans la pièce principale, c’est de l’accordéon ou bien du Franck Pourcel, ou bien cet autre disque avec sur la pochette une trompette aux pistons rutilants. Et pendant que j’écris, que je cherche de qui était ce disque – parce que les sons englobent tout, il y a l’espace, il y a le temps parfois mal délimité et puis il y a les sons qui savent tout traverser – et parce que j’ai laissé la télé allumée sur une chaîne musicale, je vois une femme, justement trompettiste (concerto de Haydn, il n’y a pas beaucoup de femmes trompettistes). Et comme je la regarde en rêvassant, quand le morceau finit, il est suivi d’un autre, concerto de Ravel sur lequel nous avions écrit tous les deux, Philippe et moi (adagio du concerto en sol majeur, longue phrase mélodique « qui coule, mais je l’ai faite mesure par mesure et j’ai failli en crever ! » disait Ravel), Philippe avait intitulé cela Enfance, et c’est le morceau qui surgit pendant que j’écris ma maison d’enfance, je ne suis pas assez haute pour l’horizon, le ciel, mais je suis assez haute pour voir ce signe qui fait partie de signes que j’appelle une main sur l’épaule. Bien sûr c’est le hasard, rien n’est organisé comme on voudrait, et, dans les faits, les morts sont morts et les vivants sont là, et le passé est révolu bien que ses surgeons se développent, c’est comme les racines, c’est flou, est-ce que l’on sait exactement à quel moment une racine s’arrête net, et est-ce que ça s’arrête net, seulement ?
Je passe mon temps à poser des questions sans consistances, à suivre leurs tracés comme des zébrures, et à attraper les réponses que le hasard répand avec sa belle obstination.
.
raku, épisode 1
Quand j’ai ouvert cette maison, j’ai pensé à beaucoup de choses, par exemple à « témoin », maison-témoin je voulais une maison qui témoigne et que chacun-chacune qui entre puisse témoigner à sa façon, pour ça qu’elle est ouverte, et que ce soit atemporel, que la maison témoin ne soit pas prise dans l’instant partageable des réseaux, un clic adieu, mais qu’elle reste, qu’elle reste là, inoccupée ou pas, quelles que soient les visites, pour ça que je renouvelle tous les ans le nom de domaine même si depuis des semaines, des mois, il n’y a qu’un capitaine ô capitaine pour tenir encore la barre bien fermement (sans lui, ce serait le fond des océans et même pas en technicolor). J’avais dans l’idée qu’on pourrait venir explorer cette maison-témoin de l’extérieur, de l’intérieur, chacun-chacune sa touche, et peu importe si le nombre d’inscrits active un peu trop les attaques de spams ou la possibilité de détourner un des mots de passe et de venir pourrir le tout. Mon approche, ma question, c’était comment vous faites, vous, dans une maison témoin et qu’est-ce que vous voyez, du dedans, du dehors ? Qu’est-ce que ça vous disait à vous les fausses pommes dans les corbeilles, les faux tableaux modernes tendance actuelle, les faux œufs dans les faux frigos et les faux livres de cartons, seulement des emballages de vide bien remplis d’air dans les bibliothèques ? J’étais un peu dans allons-y, prenons l’instant futur, et qu’est-ce qu’on fait je me disais, et qu’est-ce qu’on fait. Mais dans l’idée de maison-témoin j’avais écrit « témoin » en très grosses lettres et j’avais oublié maison, le truc banal, maison. Et donc j’ai oublié de demander et vos maisons ? Parce qu’il y en a des tas. La maison que l’on rêve et celle qu’on s’imagine connaître, la maison bien délimitée des murs apprivoisés, ceux qu’on a toujours eus, et puis la maison autre, celle de la nuit, le soir, avec les lumières du dedans, comme elle s’échappe. L’idée de maison. La maison qui reste en mémoire, et qu’est-ce qui reste, quels sons, la maison de Perec, celle où on voudrait faire ses devoirs sur la table de la cuisine. Le manque de maison, qui est aussi le manque de soi, le manque de soin, l’adieu à tout ce qui aurait pu et qui n’a pas été. Je commence à comprendre. C’est le début. La toute première maison, comme on s’y cogne et comme on n’en sort pas. Ensuite, c’est une répétition, une redite. Les autres maisons entrent en compétition, mais ça patine, de tentative en tentative. En fait la question principale ce serait : où je crèche maintenant, quand je referme la porte derrière moi, je la referme sur quoi ? La maison, ça n’a pas de contours, pourtant c’est très précis. Ça se diffuse comme une brume, pourtant c’est gorgé de détails. C’est amusant. C’est dramatique. C’est ennuyeux aussi — enfin la mienne. Je connais un potier qui fabrique de petites maisons pour les oiseaux, des sortes de caches rondes, pointues, avec la technique du raku, donc la part de hasard qui lance des chemins de craquelures dans ce qu’on appelle la glaçure. Je ne sais pas lorsqu’il malaxe la terre s’il la monte en boudins successifs, comme font les enfants. Si ma maison d’enfant avait été d’argile, elle se serait élevée sur des boudins d’ennuis, en empilement. Après, je sais qu’on dit que l’ennui est une chose excellente, que c’est bon pour la tête, il paraît qu’un enfant d’intellectuel doit s’ennuyer pour apprendre à penser. Je ne suis pas sûre. Il y a peut-être autant de variétés d’ennuis que de variations de maisons et de craquelures sur l’émail d’une poterie raku. Je commence ici un premier épisode maison dans la maison-témoin. Les œufs sont vrais et les livres il y en a, ce ne sont pas des trompe-l’œil. Je suis les craquelures du doigt, voir où ça va.
Maison maison maison
MAISON Maison Maison, c’est fou comme ce mot est flou, ou plutôt un mensonge, ou plutôt une entité inconsidérée (considérablement), est-ce que ça existe vraiment Maison, ou est-ce que ce n’est pas Sa maison, la Tienne, la Mienne qui existe, et comment étaient Leurs maisons, Celles-ci, Celles-là, se demandent les archéologues devant des alignements de fondations fossiles, parce qu’une maison ce n’est pas une donnée aérienne conceptuelle, elle existe parce qu’elle appartient à quelqu’un, dans cette façon particulière qu’elle a d’appartenance, elle existe telle qu’elle est, singulièrement, parce qu’elle est construite par quelqu’un, pour quelqu’un, qu’elle est louée à quelqu’un, vendue ou réparée par quelqu’un, pour quelqu’un, dessine-moi une maison est impossible, dessine-moi ta maison là on commence à y voir clair
PARCE qu’il y a le virtuel et le non virtuel, le non-virtuel parfois vital, je veux dire par exemple que, virtuellement, être assigné à résidence avec vu sur des cerisiers et la symphonie italienne de Mendelssohn en bain sonore ne devrait pas permettre de donner un avis éclairé aérien conceptuel sur ce qu’est une assignation à résidence mais sur la sienne seulement, seulement la sienne et s’y tenir, car résidence c’est comme maison, un mot trop vague, et pour assigner c’est pareil
ON pourrait penser que donner son avis, son avis propre, son avis seul, sans prendre de hauteur aérienne conceptuelle, c’est se priver de nourrir la grande conversation du monde, c’est peut-être l’inverse, c’est peut-être appauvrir, c’est peut-être effacer le Tu contenu dans un Et toi ? un Tu qui ne vient pas parce que, nageant dans le conceptuellement, on a perdu sa trace ?
J’entends beaucoup de gens, pas des idiots souvent, qui disent « quelle époque et quelle expérience inédite, Nous étions confinés chez Nous et ça Nous a donné un autre rapport au temps, un autre rapport à la vie », combien de claques se perdent avec ce Nous concept qui n’a pas conduit de bus, pas chargé de train, pas empilés de sacs poubelle dans un camion, pas rangé de boîtes de tomates pelées sur les rayons, pas rassemblé les caddies éparpillés sur un parking quand tout dormait, pas soigné, rien soigné, soigné personne
QUAND on a annoncé cette histoire de couvre-feu (la question des mots, c’est quelque chose, les mots mis en question c’est quelque chose, les mots c’est important on ne rigole pas avec les mots disait ce matin une intellectuelle très pointue, ajoutant que certains mouvements protestataires nous prenaient tous en otages, « en otages »), donc, couvre-feu, déplacements, horaires, j’ai pensé à guadalupe, partant avec son cif et son aspirateur nettoyer un quelconque escalier design tôt le matin, vers 4 heures sûrement, ou tard le soir, vers 22 heures, c’est-à-dire en dehors des horaires d’ouverture au public, je veux dire aux clients (car le public c’est autre chose), il semble qu’un client ne puisse pas supporter l’idée d’apercevoir quelqu’un en train de nettoyer son bureau quand il y est (aux horaires de bureau donc), cette situation est semble-t-il, pour lui, atroce, il semble qu’un client ayant payé son entrée dans un musée et déambulant au milieu des collections étrusques où il est notable selon le texte du catalogue que la place de la femme à cette période éclaire notre vision d’une perspective neuve, ce client (donc instruit) trouve insoutenable de voir un ou une collègue de guadalupe nettoyer le couloir où il avance pensif
J’AI vu guadalupe sortir son attestation signée datée document officiel prouvant qu’elle doit se conformer à la législation aux heures de l’ombre, heures de l’aube et du crépuscule, la dite-loi ne pointant pas du doigt les escaliers aux angles impraticables ni la chasse inlassable invisible de salissures et de poussières, chasse que nos pauvres yeux supportent si mal
LES yeux supportent très mal aussi les images d’abattoirs, est-ce que c’est lié ? Qu’est-ce qu’on ne veut pas voir quand on regarde, qu’est-ce qu’on ne pense pas à regarder, en tant que client ? en tant que public ? En tant qu’usagé ? À quel niveau d’usure est l’usagé ? Combien de Nous factices et de Maisons conçues dans l’air irrespirable, irrespirables ? Inacceptables ? Combien de Tu ? Et toi ?
Poète, vos paliers
Celui qui a déménagé 31 fois, et encore, je ne suis pas sûre d’avoir tout noté.
Celui qui écrivait : « J’ai une impatience diabolique de m’en aller au plus vite demeurer ailleurs. »
Celui qui avait rêvé de vivre paisiblement avec sa maman dans une « maison-joujou », sur une falaise qui s’effritait inexorablement.
Celui-là était notre premier grand poète moderne et je n’ai pas peur d’être grandiloquente.