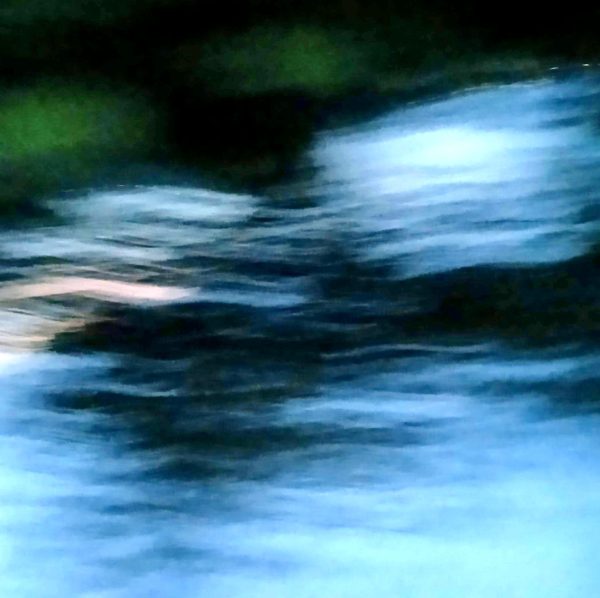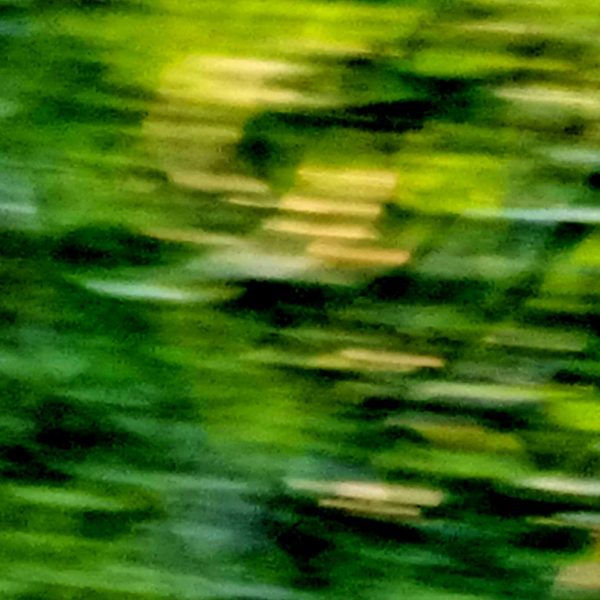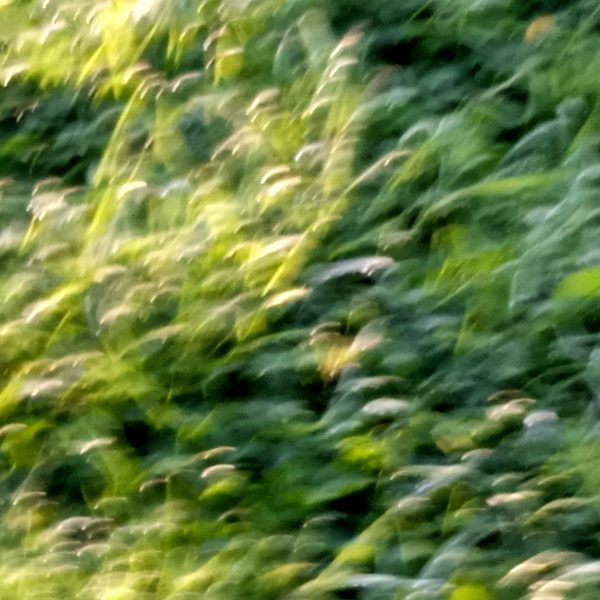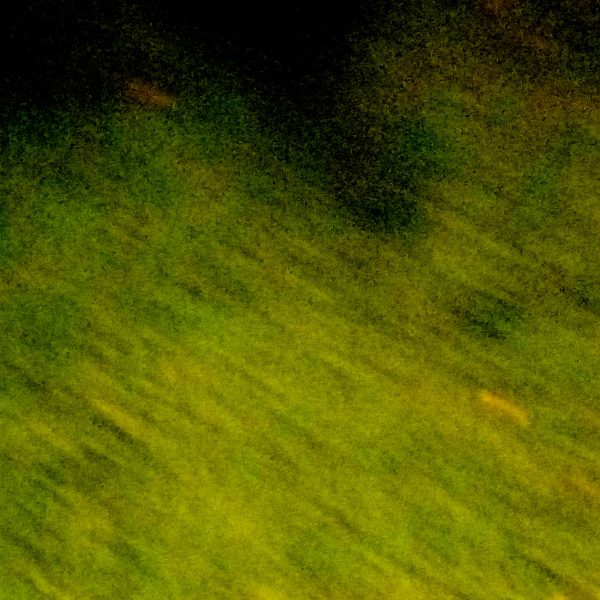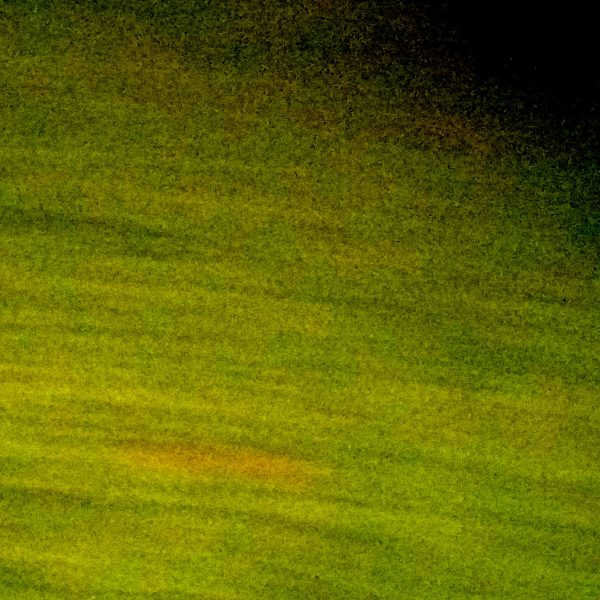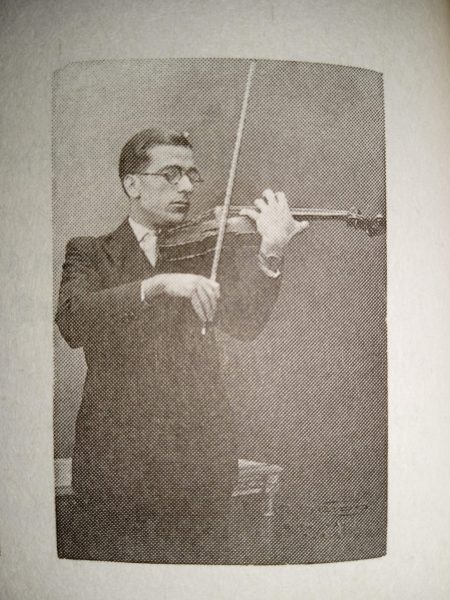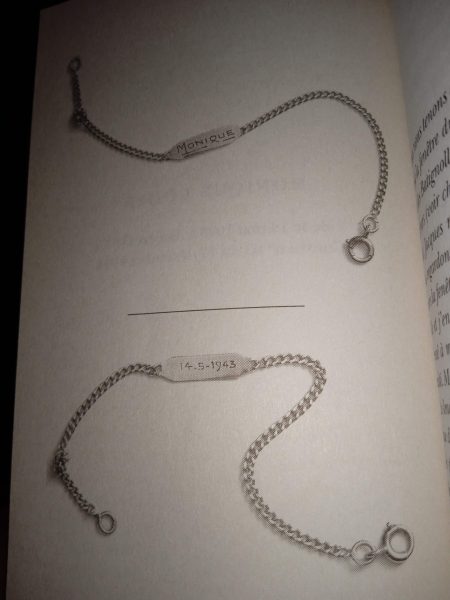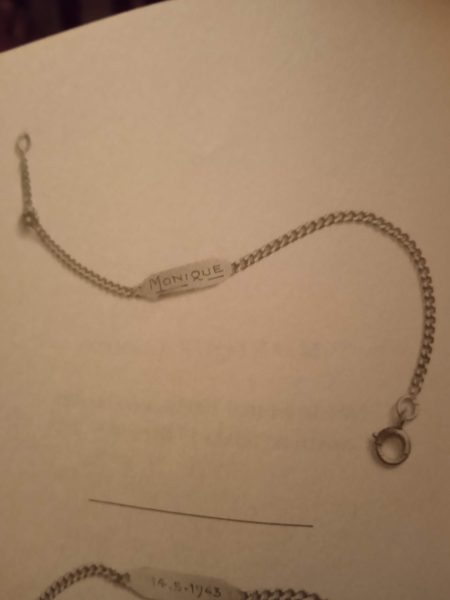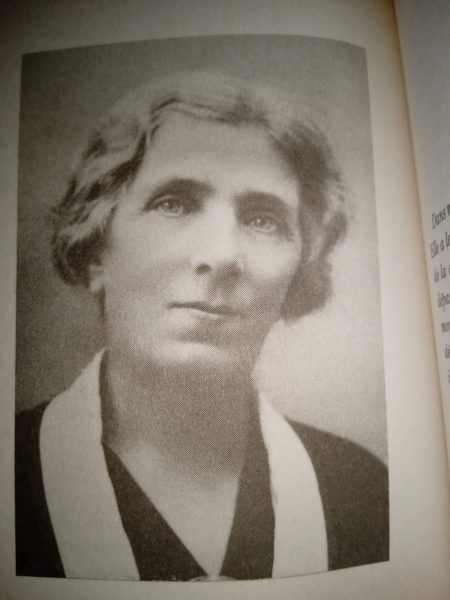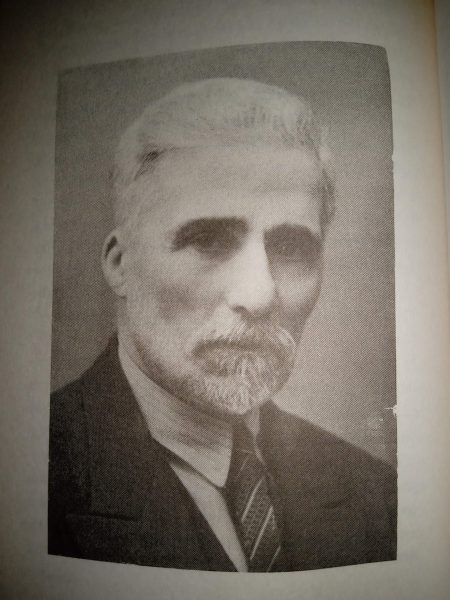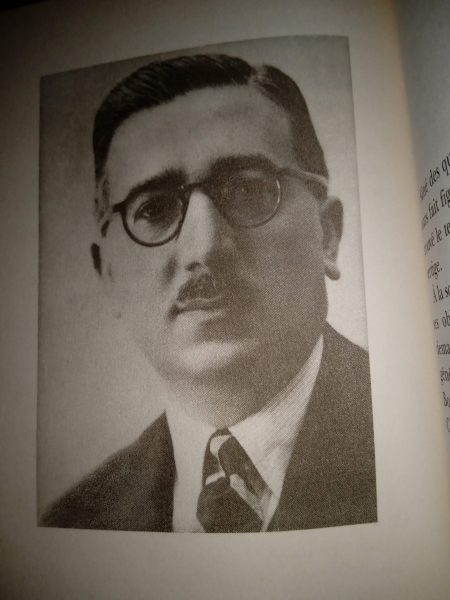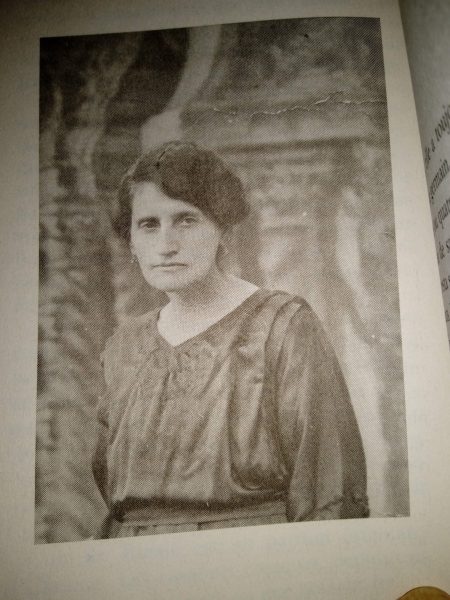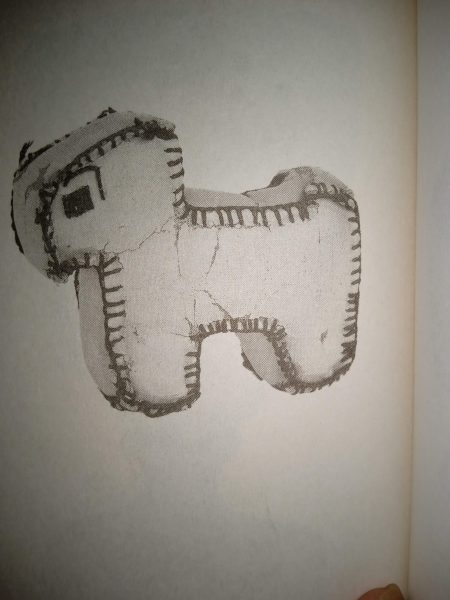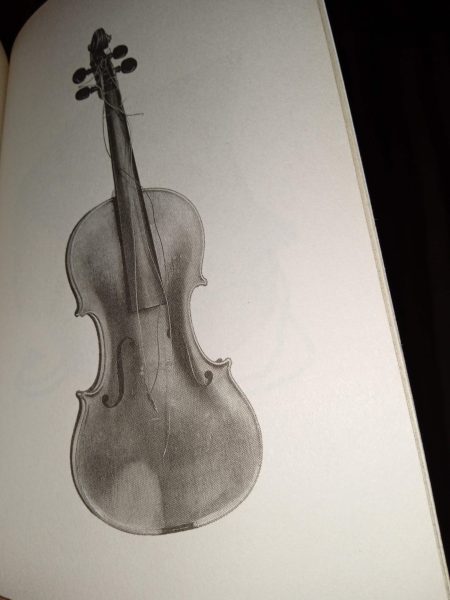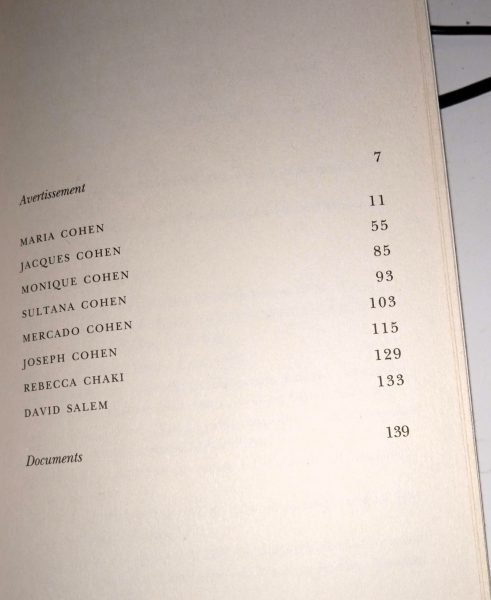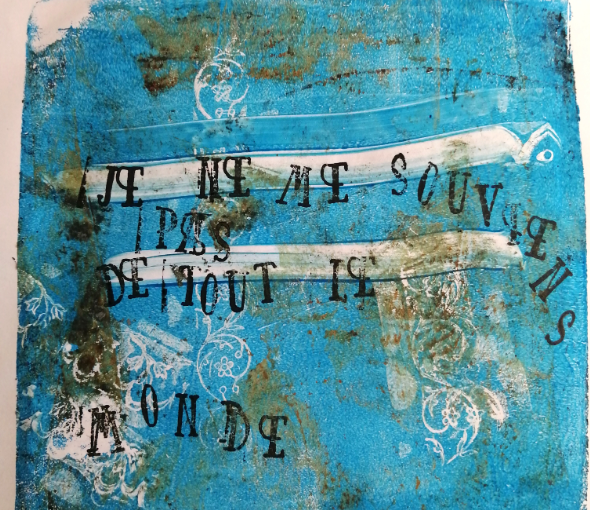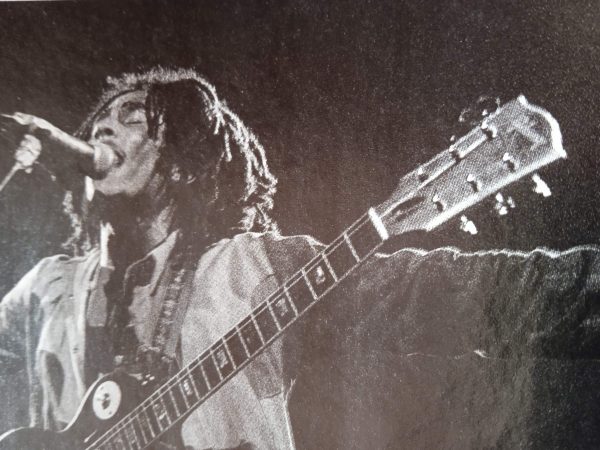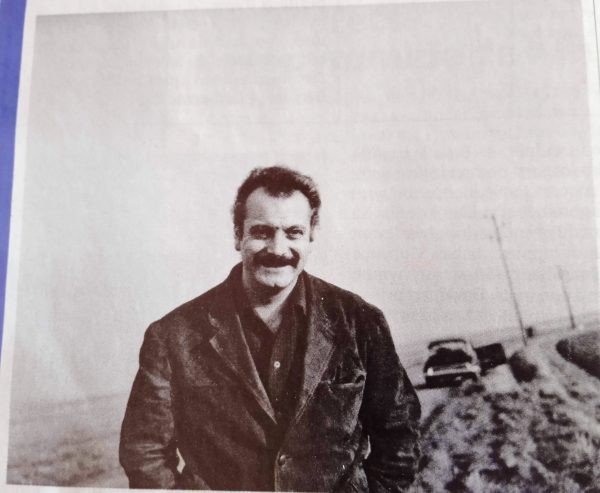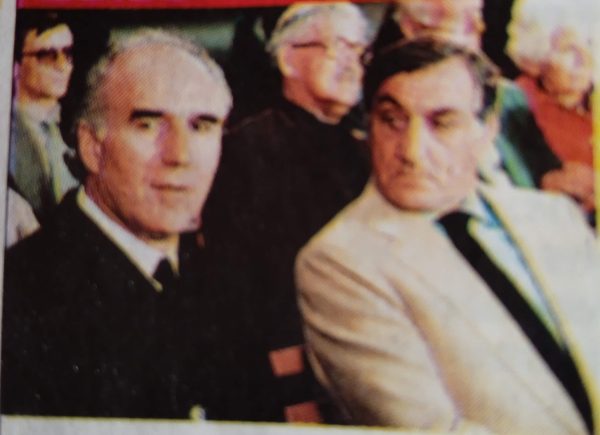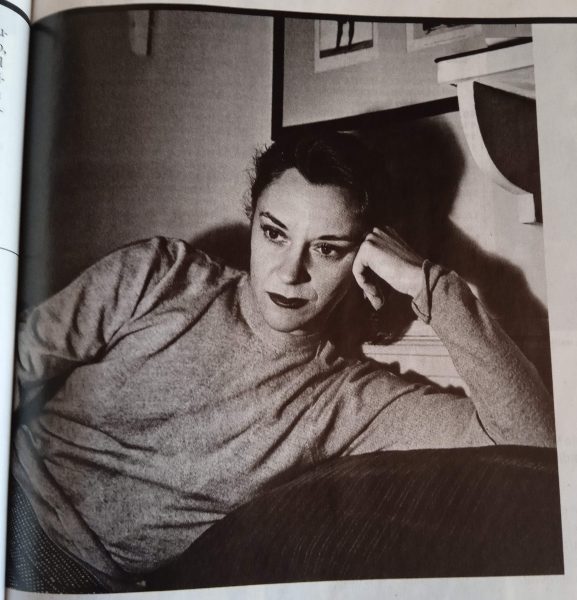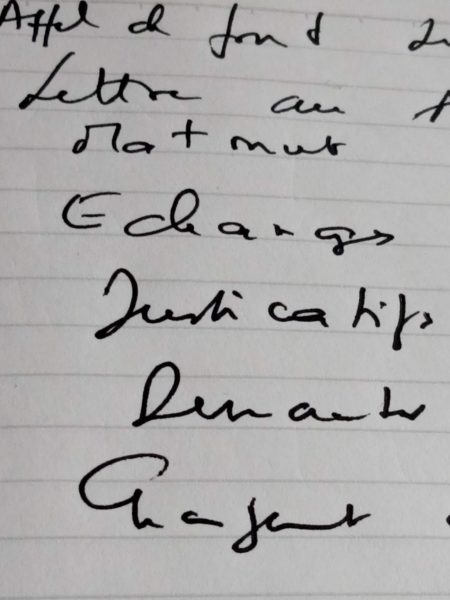(tentative de rendre compte d'un seul moment, un chantier + un fond sonore)
Entre le mur et l’échafaudage, on s’enfile,
Après ce drame et même avant, la question de
y’a juste assez de place, c’est calculé. On
la sécurité. Des salariés ont dû abandonner
va sabler les joints. Se munir d’un masque,
leurs voitures. Il y a des tension parfois.
pas oublier le masque, c’est terrible ce qu’
Il était énervé, il était perdu. Il a fallu
on respire. Poncer les briques d’abord, ça
remettre les panneaux. Comment vous faites
c’est obligatoire. La poussière orange, ça
pour sécuriser les ronds points. On a mis des
vole autour de la tête. C’est chassé à gauche,
ballots de paille. Les gendarmes ont mon
à droite, selon le geste. Puis on fait des
numéro de téléphone. C’est des choses qu’on
cercles si on veut fignoler. Attention quand
ne veut pas voir ici. Un mot encore sur la
ça ripe, y’a des étincelles, parce que le coin
centrale nucléaire, la circulation est un
des pierres ça pardonne pas. On décale les
petit peu compliquée. Il y a encore plus de
cercles en avançant, faut y aller doux, être
blocages ce matin. Il n’est pas question
méticuleux, pas mesurer son temps, c’est la
d’envoyer des forces de l’ordre contre eux.
base. Le joint est appliqué à la truelle, puis
C’est un drame. Je ne sais pas. Ça se passe
, lorsqu’il n’a pas encore durci, lissé avec
dans un état d’esprit constructif. C’est un
le gant. Façade, rejointement, enduit. Le but
tournant. Exaspération, on sait les problèmes.
c’est de dégrossir, d’aplatir, toujours de
Y’a pas que ça. Si l’on en croit les calculs,
gauche à droite. Perçeuse, marteau et on y va.
une baisse alors qu’il y a une hausse. Il faut
C’est un gruyère, c’est même pas maçonné, la
continuer à aider mais on ne mesure pas les
lumière traverse le mur, y’a rien qui tient.
conséquences. On peut avoir envie d’aller vers
Oh, ce boulot. C’est parti comme ça. Monter
un poulet un peu moins cher. Il y a des hommes
jusque sous la toiture. Autour des fenêtres,
des femmes qui se battent, et même au péril de
la mèche de la perceuse s’enfonce en suivant
leur vie. On marche sur la tête. Le dilemme
la bordure de la pierre. Passer le karcher
est là. Cette inflation persistante. Les
dans les joints. Nettoyer les pierres de la
français préfèrent les produits moins chers.
mousse et du lichen qui se sont incrustés.
L’exemple des cerises : on ne peut pas
Je vais trouver un produit pour ça à la
utiliser un pesticide, elles sont chères.
quincaillerie, à base de vinaigre. Ça met du
D’après nos informations c’est bien la thèse
temps à agir, c’est pas parti entièrement mais
d’un accident qui est privilégiée. Vous
ça va le faire. Enlever les gravats, le sable,
connaissez la musique. Je baisse. J’éteins.
en raclant le sol à la pelle, et puis jeter la
Je décale, et je lève le pied. Chaque geste
pelletée dans la brouette. C’est propre. Il
compte pour la planète. Et comme on vous
faut que le mortier solidifie tout. Nettoyer
connaît très bien, on sait que ça va vous
au jet d’eau avant. Trois seaux de sable pour
plaire. Découvrir, explorer, s’informer,
un seau de chaux. C’est vraiment la méthode
le meilleur du réel. Pas d’empreintes, pas
traditionnelle. On part du haut, on descend,
d’ADN, le crime parfait. Il est neuf
on fait des lignes. C’est long, c’est long
heures. On revient sur les images parlantes.
mais c’est long. Après il va falloir gratter
Une vague de délinquance sans précédent. Le
à la brosse métallique pour remettre à niveau.
groupe sécurité de proximité quadrille le
On dégrossit bien. Si on a trop attendu et que
quartier. Est-ce qu’on sera prêt. Est-ce
c’est trop sec, on remouille un peu, et la
qu’il faut raser. La réponse économique,
poussière vole moins, mais on n’oublie pas le
l’impact est direct. Il se lève très tôt
masque. La langue de chat sert à repousser
pour répondre à toutes vos question. Il
bien au fond pour que le mortier pris sur la
n’y a quasiment plus aucune maison debout ici.
lisseuse ne tombe pas. Nettoyer les coulures.
("mitan" à cause de la séparation)
(et de la chanson, dans le mitan du lit, dans le mitan du lit, la rivière est profonde lonla, la rivière est profonde)