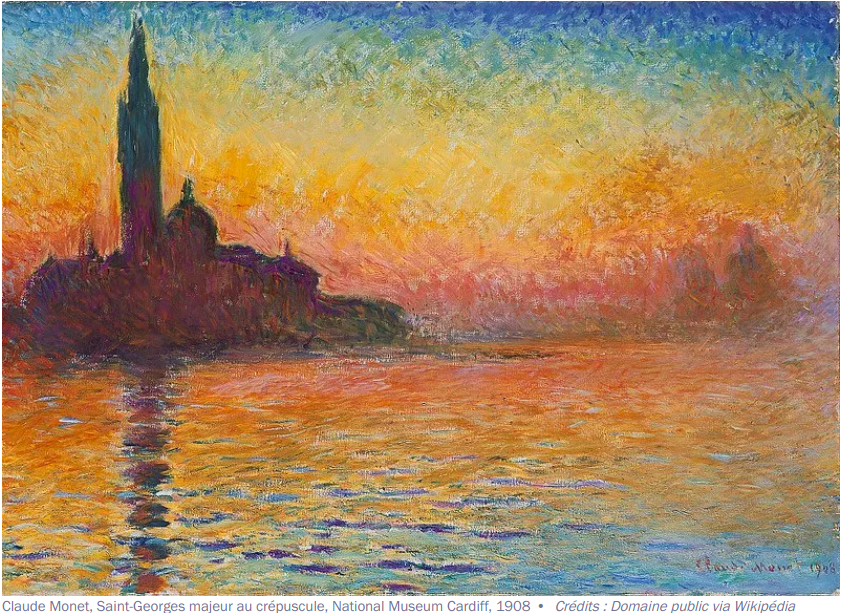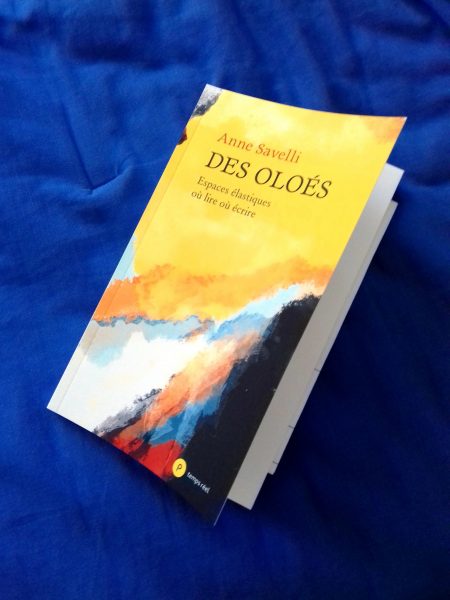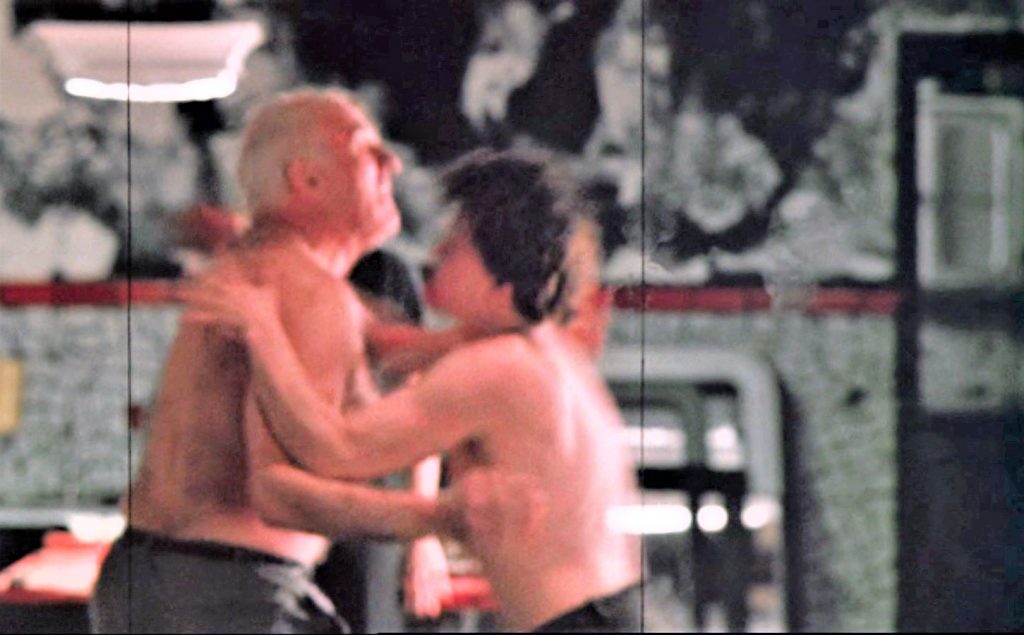Résister
(dernière carte postale de sconfinication-réclusion)
il y a pas mal de choses qui semblent évoluer – la relation qu’on entretient avec les avions; celle qu’on nous oblige à adopter vis à vis du travail (sa version -l’aversion qu’on peut en avoir – virtuelle, distancielle, présentielle – logicielle progicielle et tout ce que tu veux – entre présence et distanciation (immondice technocratique) on a vite choisi ? je veux dire les collègues qu’on agonit, ne plus les voir, quelle bénédiction… ne plus les entendre, quelle aubaine – oui, les autres qui faisaient avancer la barque aussi dans le même sens que vous ? on les oublie, on les appelle, on les joint ?) ; les vacances (où est-ce qu’on va ???); le monde d’ici : qui où quand ? ; les chroniques, les épisodes, les billets; les connexions, les consommations, les évaluations, les entretiens annuels, les comparaisons, les autres, les uns, les âges ? qui, les salariés ? les prestataires ? les auto-entrepreneurs? les ubérisés à quatre sur une 508 ?
(j’apprends à ce moment la mort, la disparition, l’envol de Jean-Loup Dabadie scénariste dialoguiste qui me faisait l’effet de Jean-Claude Carrière, quelque chose de Claude Sautet et une certaine vraie qualité française) – ah le monde, la vie, les gens… – ses/les chansons (« attends je sais des histoires… »)
c’est un peu ce genre de choses qui aurait tendance à occulter ce à quoi on était en train de penser : la mort rôde, d’un certain sens – un texto tout à l’heure de l’ami apap qui m’informe de la disparition d’un être connu de lui (on en avait parlé il y a quelques semaines, ainsi les choses se délitent-elles – un coma prolongé, la maladie épidémique) de moi aussi de plus loin – l’homme ainsi que moi était asthmatique – à risque, la cinquantaine je crois – pour JLD quatre vingt un balais le rire la joie en un sens et Romy Schneider – il a fallu que ça tombe sur cette maison au moment où j’y écris une autre histoire de l’agent
juste après voilà que j’apprends la mort d’Albert Memmi, quatre vingt dix neuf ans, mais je n’ai rien lu de lui – cependant tellement proche…- la paix sur son âme
on ferait mieux de boire un verre à sa santé peut-être – c’est fait –
« alors on boit un verre/ en regardant loin/ derrière la glace du comptoir/ et on se dit qu’il est bien tard/ il est bien tard… »
dans la cuisine à côté cuit doucement la sauce tomate des pâtes du soir – on avait été se promener quelque part où il y a des milliers de ce genre de plantes qui fleurit en mai
on ne sait jamais comment ça va tourner (par exemple, tout à l’heure – raconté ailleurs, mais on s’en fout) – on frappe à la porte on me tend un paquet (oui, c’est moi, oui) on s’en va (on était une femme qui conduisait un fourgon banalisé et blanc et qui livrait avec icelui des colis chronopost) j’ouvre le petit livre Les oloés de madame Savelli (merci) dans lequel je retrouve (outre un certain nombre d’ami.e.s) Maryse Hache (à laquelle le livre est dédié, de même que ce billet – et d’ailleurs tous les billets de cette maison[serait-elle]témoin)
c’est chez publie.net – une bonne maison – je ne me perds pas vraiment, mais entre ici, là et là-bas sans compter ailleurs et ici même, j’ai des difficultés – la mémoire qui flanche (je ne me souviens plus très bien) (c’est une chanson) (non, je n’ai pas oublié…)
je parlais du travail, mais c’en est fini, mon petit – non, en effet, je n’ai jamais grandi, je me souviens encore de mes premières années, un autre continent, de l’autre côté de la mer, je cherche à me souvenir mais longtemps (parce que j’avais à l’âme cette image de France – un peu comme le Fossoyeur du poète « avec à l’âme un grand courage/il s’en allait trimer aux champs« ) longtemps j’ai conservé cette image de ce pays comme quelque chose d’incivilisé (étais-je rapatrié ?), une partie de moi-même était sauvage (elle l’est toujours) (par exemple, laisse-moi deux jours au soleil, je deviens noir), elle n’avait pas droit de cité – ces idées-là qu’on ne disait pas, à l’école de A. où le directeur faisait violence à ses élèves (le monde n’était pas si différent, des choses étaient permises, d’autres sans doute moins – aujourd’hui, on interdit une claque, alors c’était bénin) – les moments d’incompréhension (ça valait mieux) les moments de rigolade (dieu merci (ah ! ma grand-mère…) ma famille m’aimait de la même eau que j’avais pour elle) ceux de la panique – la neige, les pleurs, les attentes – non, tous les jours disparaissent ceux qu’on aime et puis, va le monde, coure la jeunesse, sourient les jeunes femmes – il fait beau aussi parfois – « c’est fini, la mer, c’est fini…«