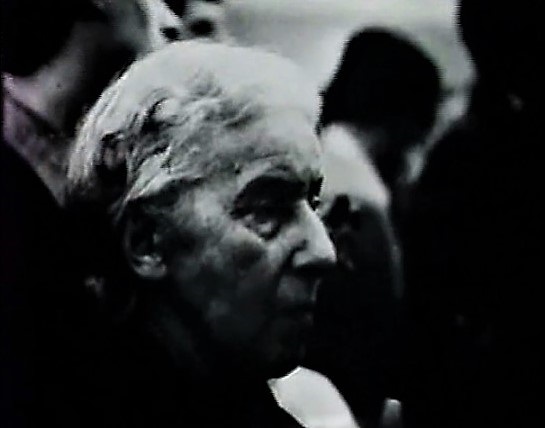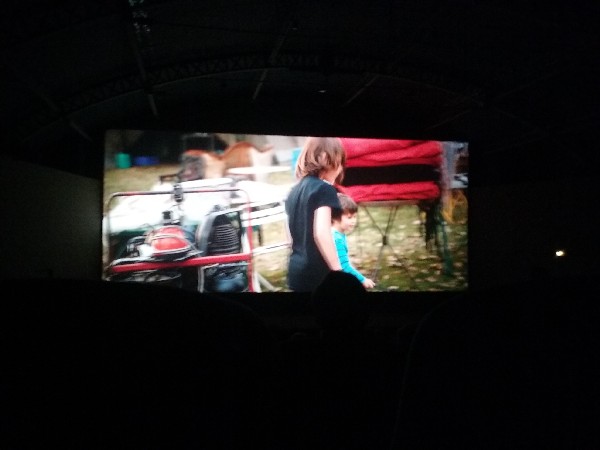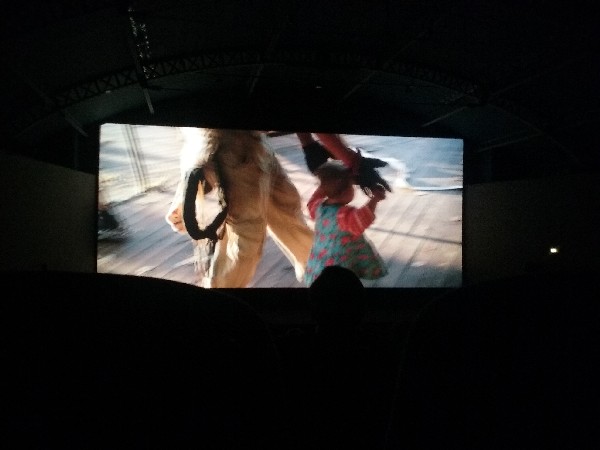Nous sommes bousculés, nous sommes traumatisés, trahis blessés mortellement, dans notre humanité-même : comment, des gens comme nous, deux bras deux jambes neuf orifices et vingt doigts, des êtres humains sont donc capables de ça ? Oui. Hier ici, aujourd’hui, à Bruxelles, oui. C’est peu dire que c’est lâche, c’est peu dire que c’est laid. Ce n’est pas qu’il nous faille pourtant ne pas concevoir cette éventualité : ils (elles ? je ne sais pas, mais je suis sûr qu’elles sont moins nombreuses qu’eux), ce sont eux, ils tuent, l’aveuglement et le hasard qui frappent, ah ne pas baisser les bras, ne pas se laisser envahir par la peur, continuer à encore et toujours vouloir tenter de comprendre et d’aimer les autres, oui, tenter, et continuer. Sortir, rire, applaudir… Nous sommes tous atteints, mais nous vivons encore pour à tout le moins dire que la vie est belle, bien plus belle encore que ce qu’ils peuvent imaginer. Ils ne gagneront jamais.
(de la promotion : quand on pose le lien vers maison(s)témoin sur la page fb de « Homeland« , on obtient un « like » comme réponse; même procédé sur celle de « Merci patron » : rien à voir, circulez- il ne s’agit pas de glaner reconnaissance ou orgueil ou quoi que ce soit de ce genre, mais de dire que proposer des goûts à nos contemporains est accueilli défavorablement, dire ce qu’on pense en réalité a quelque chose, ici, probablement, de déplacé, il ne faudrait pas le faire valoir. Je vais parler d’un film français, vu il y a deux jours; en sortant du cinéma sur le sol j’ai trouvé ça

par terre sur le trottoir de l’avenue de Clichy. Ca ne m’a pas tellement plu, mais je crois que c’est parce que, depuis, l’accueil du film a été dithyrambique – à ce que j’en ai vu ici ou là- et que cet unanimisme ne me convient pas. Happy few, agitation propagande, avant-garde, aujourd’hui (nous sommes le 22 mars) flotte dans l’air quelque chose-un anniversaire, probablement. Quarante sept ans, j’aime à m’en souvenir. J’avais quinze ans et j’écoutais la radio, le poste périphérique relaterait, six ou huit semaines plus tard quelques uns des événements qui nous ont marqués, certes, mais qui se terminent (le mot est lourd), qui aboutissent, à ce que j’en vois aujourd’hui, à une sorte d’eau de boudin complètement indigeste. Ces temps-ci, pour ma part, ça va mal. Mais dans la salle de cinéma, à la fin, quelques unes des personnes présentes ont applaudi; pendant la séance, on en entendait certaines renifler (il y a parfois des moments tragiques), plus souvent on riait (il y a pas mal de moments drôles). N’importe, ici, dans cette maison, c’est comme si de rien n’était : j’avance, je pose, je laisse, je m’en vais, j’essaye juste de vivre et de continuer à aimer le cinéma).

Cette image-là est à la fin. Le « Davaï Théâtre » (qui s’inspire dit-on d’une troupe de théâtre itinérant) s’en va sur une route déserte dans le soleil couchant. C’est une troupe, une espèce de cirque qui, au lieu de numéros de montreurs d’ours ou de dresseurs de puces, de contorsionnistes acrobates jongleurs de clowns ou de magiciens, donne en représentation deux pièces de Tchekhov adaptées et mises bout à bout pour les besoins du spectacle. On est en été – en hiver, on ne circule pas, je ne crois pas. On serait à Palavas-les-flots qu’on n’en serait pas tellement étonnés (j’ai pensé à ce film de Nicole Gracia, « Un beau dimanche » 2013) (je ne me souviens plus, mais durant la parade, on sait qu’on se trouve quelque part par là – je veux dire, comme pour « Un beau dimanche » en bord de mer, en été) (ça me revient, une fille dit « on n’est pas à New-York ici, on est à Port-la-Nouvelle »).
Il règne dans cette troupe quelque chose comme une ambiance on dit aujourd’hui « déjantée » ou mieux « foutraque » ou pire « jubilatoire ». En un mot, tout cela est furieusement contemporain, disons. Drôle, cynique, émouvant, sans principe. Si les choses tournent mal, le père -le directeur de la troupe (il a dans les soixante ans)- demandera de l’ordre, du bourgeois du propre. La vie de la troupe, c’est aussi recevoir des enfants, type cinq ou six ans : l’un des acteurs (il est atteint par la mort de maladie de son fils, et le voilà qui va devenir père -sans doute tape-t-il dans les quarante balais, il boit fume prend des médicaments -on l’a nommé « Déloyal » comme patronyme, pourquoi pas mais c’est dur à porter…) l’un des acteurs donc, à cette occasion, propose à ces jeunes têtes blondes une pédagogie douteuse (qu’est-ce que la sodomie) à l’aide de dessins. C’est un autre scandale, qui fait suite au précédent (une bataille rangée dans un restaurant maghrébin où le Déloyal en question a mis le feu aux poudres en les traitant de « bougnoules » – comme on voit, le Déloyal ne lésine pas sur les moyens).

Non, ça ne lésine pas, mais enfin, le titre du film m’a (comment dire ?) questionné ? interpellé ? enfin…) posé question, je ne sais pas, m’a rappelé l’enfance (il y a beaucoup d’enfants dans le film
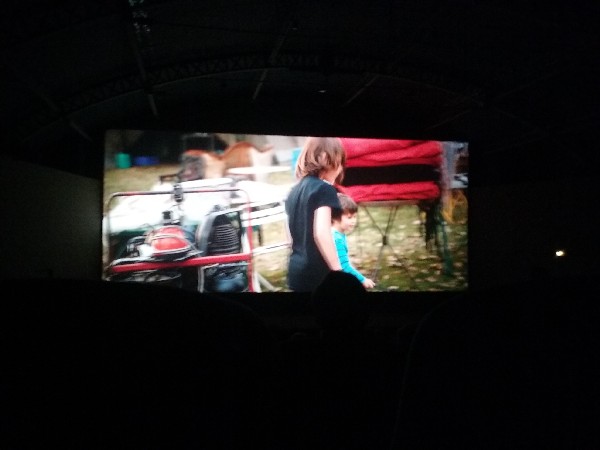
et on peut dire sans trop tirer la couverture de ce côté-là
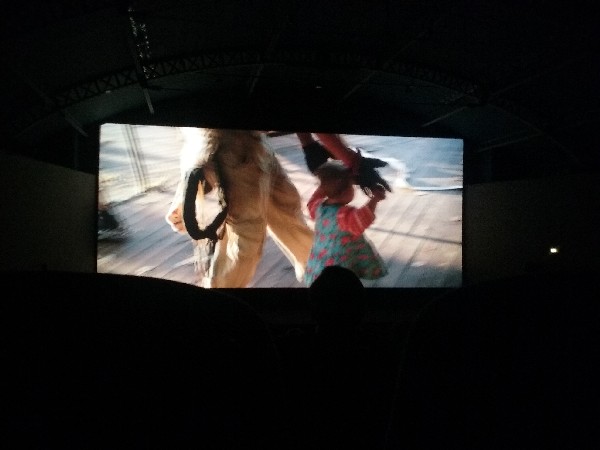
qu’en réalité, ça ne parle que de ça) et ses contes : n’est-ce pas, les ogres mangent les enfants dans les contes (comme les loups, d’ailleurs) (quelques animaux sont là, oies, poulet en habit, chiens…), ceux-ci sont-ils d’un autre genre ? Des ogresses, en est-il aussi ?

Quelque chose du délit, de la tragédie, quelque chose de l’outrance, de l’obscène aussi (fatalement : on représente, une pièce de théâtre, on en voit les coulisses, on est avec les acteurs, on joue presque avec eux, la caméra ne sait plus où donner de l’objectif, mais enfin la lumière, le petit matin et les mégots de cigarettes dans le beurre…).

Déloyal va mourir : il écrase sur une planche des médicaments, beaucoup de médicaments, imprègne de ce mélange un morceau de pain ou quelque chose, puis change d’avis, jette ledit truc quelque part où une oie va le manger, s’en va, il nous quitte… De la même manière, la fille (qui est la soeur de la réalisatrice, et qui a donc le même père -on suit ?) de l’histoire à un moment, prend ses enfants et s’en va : sans elle, comment va-t-on faire ? On se rend compte qu’elle est partout dans la construction de la pièce, partout dans l’intendance, partout dans le rapport au monde. Mais elle est partie… On ne la reverra pas, elle téléphone à sa mère mais non, on ne la revoit pas. Le film avance, naît un enfant (c’est un garçon) et se termine, on est ému, on a tellement aimé la musique (on pense à Plume, on pense à tous ces artistes de cirque qui veulent à toute force créer quelque chose comme une histoire), on va s’en aller on sort (je crois que la musique est due au mari de la soeur de la réalisatrice, mais ça, ce serait à vérifier)

sur l’avenue cette image, dans le métro cette autre

il y a des choses qu’on aime (en revenant-comme en y allant, on passe devant le théâtre des Bouffes du nord

le reflet des voyageurs aux fenêtres), on se souvient un peu du film, de la joie de vivre comme du pathétique toujours à fleur d’image, l’outrance mais la joie de vivre, cette espèce de vulgarité assumée, revendiquée, potache sans doute mais vraie aussi, et comme il se termine bien

(sans vouloir non plus tomber dans le culte de la personnalité), on remercie cette jeune femme, Léa Fehner (et ses parents et ses amis) pour les deux heures et demie de bonheur cinématographique qu’elle et eux nous ont donné.