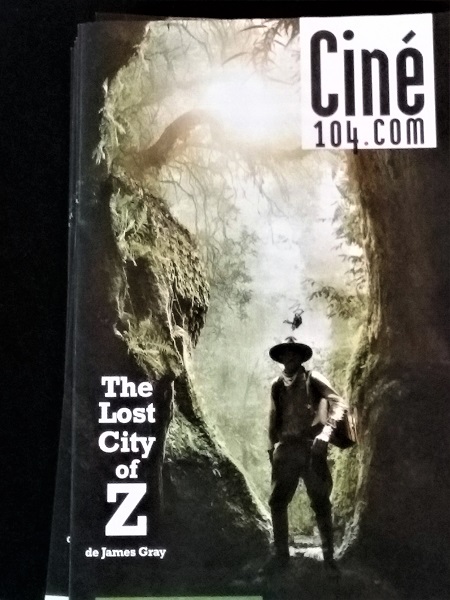photo d'entrée de billet : la plage municipale de Casablanca ( (c)Yassine Mounaim pour GSW, réglages et cadrage PCH)
Dans son charmant pied-à-terre qui donne sur le grand canal, Peggy a fait installer (enfouir, sans doute) les sépultures de ses chiens (il y en a une tripotée) et je crois bien aussi (peut-être que ce fait mériterait d’être vérifié, étayé, recoupé et légitimement accepté et alors communiqué) l’urne qui contient (au moins) une partie des cendres recueillies lorsque sa dépouille (sans plus de vie) a été brûlée (aux alentours de la Noël 1979) quelque part par là, dans les jardins du palais inachevé (dit Venier dei Leoni, du nom de la famille qui donna à la Sérénissime trois de ses doges dont le vainqueur de la bataille de Lépante, c’est dire si l’affaire est fichée dans le marbre
quelque part par là, dans les jardins du palais inachevé (dit Venier dei Leoni, du nom de la famille qui donna à la Sérénissime trois de ses doges dont le vainqueur de la bataille de Lépante, c’est dire si l’affaire est fichée dans le marbre de Carrare ou d’Istrie, je ne suis pas certain).
de Carrare ou d’Istrie, je ne suis pas certain).
Ceci pour indiquer que, dans le jardin de cette maison, serait-elle témoin – mais il y a de la pérennisation dans l’air (date à compter du 13 mai 15 soit deux ans et demi, pile le jour de la rédaction du billet deux cent quatre vingt dix huitième du nom) – il serait bon de prévoir un lieu où entreposer, laisser reposer, laisser et oublier les restes de certains fantômes (de compagnie, ou non) et autres innocences inconnues de nous comme d’elles-mêmes, et nous y porterions quelques fleurs, de temps à autre, nous y poserions des arbres la pluie en novembre, la neige et l’hiver, on essayerait d’y survivre comme tous les ans oubliant les erreurs et les impasses, ne pensant qu’à l’avenir, qu’à nos proches et nos amis, puis aux autres et aux autres encore. Que ces mots et ces images trouvent quelque pardon en vos lectures, Venise fait partie (ainsi que les lions – on aurait pu intituler ces trois là du #313 – ce sera peut-être fait d’ici là – et c’est fait) d’une espèce de tropisme qu’il m’est difficile, voire impossible, de refréner (d’ailleurs je n’y tiens pas spécialement, à vrai dire). Car enfin, le film (magnifique) dont il va être question n’a rien à voir avec Peggy, Venise ou les lions. Mais seulement avec les fantômes.
la pluie en novembre, la neige et l’hiver, on essayerait d’y survivre comme tous les ans oubliant les erreurs et les impasses, ne pensant qu’à l’avenir, qu’à nos proches et nos amis, puis aux autres et aux autres encore. Que ces mots et ces images trouvent quelque pardon en vos lectures, Venise fait partie (ainsi que les lions – on aurait pu intituler ces trois là du #313 – ce sera peut-être fait d’ici là – et c’est fait) d’une espèce de tropisme qu’il m’est difficile, voire impossible, de refréner (d’ailleurs je n’y tiens pas spécialement, à vrai dire). Car enfin, le film (magnifique) dont il va être question n’a rien à voir avec Peggy, Venise ou les lions. Mais seulement avec les fantômes.
Il y aura trois générations qui apparaîtront en image. Le réalisateur, ses parents et son fils, prénommé Balthazar. Une histoire de famille qui va d’Espagne (pour les grands parents – ils ne sont plus) au Maroc, là où se marient les parents
dans les années cinquante, puis la France dans les années soixante où leur naquirent deux fils, dont l’un
a ourdi ce film. Un film d’histoire qui nous raconte ce qui, au début des années soixante, puis plus tard, agitait le pays (celui-ci, la France et ses colonies bientôt ou déjà libres de protectorat). L’histoire d’une famille, d’une mère peut-être parfois tourmentée
 un peu dirait-on (cette photo sans doute du début des années soixante dix). Puis, nous les verrons, ce père et cette femme, de nos jours. Une histoire d’enfant disparue, une fille prénommée Christine, décédée au début des années soixante, et qu’ils auront tenté d’oublier. Un homme finit sa vie (on le voit aussi, d’un plan, mort sur son lit d’hôpital)
un peu dirait-on (cette photo sans doute du début des années soixante dix). Puis, nous les verrons, ce père et cette femme, de nos jours. Une histoire d’enfant disparue, une fille prénommée Christine, décédée au début des années soixante, et qu’ils auront tenté d’oublier. Un homme finit sa vie (on le voit aussi, d’un plan, mort sur son lit d’hôpital) puis une femme qui niait l’évidence, puis ne cachera plus ses tentatives de réaménager le passé, peut-être même l’acceptera-t-elle, on la verra sur la tombe de son enfant (située dans le carré 35 du cimetière français de Casablanca – lequel carré n’existe pas plus que notre maison(s)témoin, c’est pour te dire…), photo disparue, peut-être reposée ensuite, à Casablanca, au bord de l’océan, là où elle l’avait confiée à une soeur sienne.
puis une femme qui niait l’évidence, puis ne cachera plus ses tentatives de réaménager le passé, peut-être même l’acceptera-t-elle, on la verra sur la tombe de son enfant (située dans le carré 35 du cimetière français de Casablanca – lequel carré n’existe pas plus que notre maison(s)témoin, c’est pour te dire…), photo disparue, peut-être reposée ensuite, à Casablanca, au bord de l’océan, là où elle l’avait confiée à une soeur sienne.
Une des merveilles, c’est de l’y avoir ré-emmenée, cette femme, sur ces lieux…
Choses tues et cachées, oubliées, tramées, perdues, de la mémoire on tentait bien de les chasser en les transformant en quelque chose de plus acceptable parce que cette douleur-là, la perte d’une enfant, est indicible, et d’autant plus indicible que cette perte-là était presque désirée (mais ne l’est-elle pas chez nous tous ? à peine audible, visible, dicible tout autant, taire, et garder pour ceux-là tout notre amour). Choses tues , oubliées et cachées mais qui réapparaissent : passant d’un esprit à l’autre, sans mot dire, là où est cachée la vérité, là d’où il faudra la mettre au jour afin qu’elle ne blesse pas le nouveau venu… Balthazar, donc, alors : longue vie à lui, si possible…
Encore une chose, cependant, sur le bord de l’eau. Une image qu’on voit, pas si fugitive : j’avais à l’idée cette chanson de Michel Jonasz « Les vacances au bord de la mer » (« avec mon père ma soeur ma mère » y chante-t-il), la mise au point sur le côté si tramée gommée oublieuse des détails… parce que le point est sur cette petite fille qui a froid ou peur, ou quelque chose
parce que le point est sur cette petite fille qui a froid ou peur, ou quelque chose regard caméra presque, on peut le croire, elle ne bouge ni ne sourit… De longues images de l’eau, qui bouillonne ou qui envahit l’écran, comme quelque chose qu’il faudrait qu’on se dise, entre nous, sans un mot.
regard caméra presque, on peut le croire, elle ne bouge ni ne sourit… De longues images de l’eau, qui bouillonne ou qui envahit l’écran, comme quelque chose qu’il faudrait qu’on se dise, entre nous, sans un mot.
Une merveille.
« Carré 35« , un film d’Eric Caravaca.




































 il s’agissait d’enquêter de nuit, un spectacle autour d’une exposition, ou l’inverse, électrique, flippers et musique à rompre les tympans (électronique, deux pistes de danse, des jeunes gens soûls et défoncés, qui n’en a pas vu ou croisé ? jusque cinq heures, approcher les personnes qui sortent je me souviens de ce travail, l’un des plus difficiles) (un autre sur la projection en continu – huit heures du soir/neuf heures du matin – du feuilleton « Berlin Alexander platz », on sortait de là ébahis…), j’ai été remercié (c’est ainsi qu’on dit) pour ce travail, les gens sont encore sans doute en place j’imagine (TNPPI pourtant, je sais bien)
il s’agissait d’enquêter de nuit, un spectacle autour d’une exposition, ou l’inverse, électrique, flippers et musique à rompre les tympans (électronique, deux pistes de danse, des jeunes gens soûls et défoncés, qui n’en a pas vu ou croisé ? jusque cinq heures, approcher les personnes qui sortent je me souviens de ce travail, l’un des plus difficiles) (un autre sur la projection en continu – huit heures du soir/neuf heures du matin – du feuilleton « Berlin Alexander platz », on sortait de là ébahis…), j’ai été remercié (c’est ainsi qu’on dit) pour ce travail, les gens sont encore sans doute en place j’imagine (TNPPI pourtant, je sais bien)