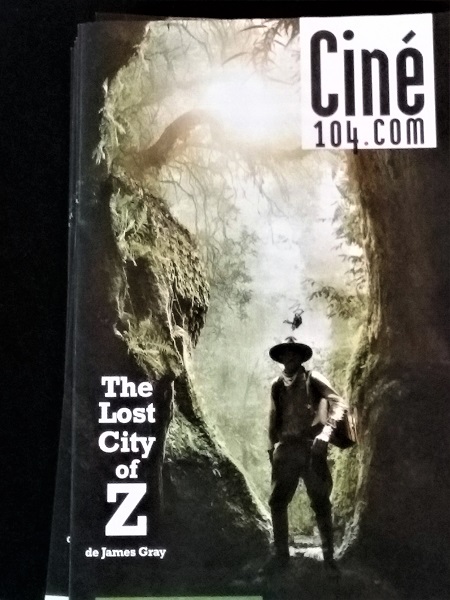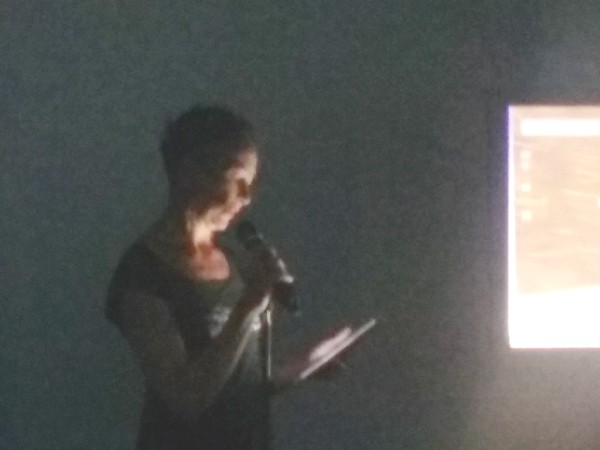Entretenir sa santé. Courir, avaler des kilomètres, chaussé de sport, vêtements assortis et justaucorps, casquettes et aux oreilles une musique quelconque, qu’on aime sans doute, au loin passent les cigognes
Entretenir sa santé. Courir, avaler des kilomètres, chaussé de sport, vêtements assortis et justaucorps, casquettes et aux oreilles une musique quelconque, qu’on aime sans doute, au loin passent les cigognes
ce ne sont que des gens, bipèdes forcenés, l’âge de leurs artères, courir pour ne pas mourir, pour ne pas vieillir, courir après quelque chose de désirable, courir et respirer, respirer et encore respirer, courir encore quelques pas dans un air presque pur, préserver ses capacités pour les mettre au service de sa feuille de paye, les virements ici les agios là, les intérêts et les marges, parce que le crédit qui va le payer, la maison, bien sûr, nous convenait comme le gant à la main, elle nous était prédestinée sûrement, dès que nous y sommes entrés, ça a été comme un coup de foudre, bien sûr pour nous
et pour notre fille à venir, puis le deuxième enfant, oui, le tout est de continuer à courir, courir, voilà, courir, les lotissements, les voitures, l’électricité, l’atome aussi bien, les avions et les embouteillages de la fin des vacances, tu sais quoi ? j’ai adoré écrire cette histoire, il y avait des trains qui allaient et venaient, tout le jour, dès le matin, ces maisons qu’on trouve dans des enlacements en impasse, ces maisons toutes semblables, j’ai pensé aussi à elles lorsque le milliardaire qui s’en était fait le maçon s’est offert la douane de mer à Venise, après s’être acheté un palais sur le grand canal, courir, éliminer les toxines, courir encore, suer tant bien que mal, avancer sur le chemin de ce destin écrit pour nous, courir, sentir cette chaleur dispensée par nos muscles qui travaillent, travailler, courir, travailler
 il y avait eu cette émission de radio, aussi, où on nous expliquait que chacun dans son coin faisait ce qu’il avait envie de faire, au milieu des autres, la vie urbaine, la vie en ville, la vie dans sa propre maison, courir autour du lotissement, autour des hectares de verdure, les montées et les descentes des Buttes Chaumont, les landaus du parc Montceau, les appareils photo et les cannes à selfie des Tuileries
il y avait eu cette émission de radio, aussi, où on nous expliquait que chacun dans son coin faisait ce qu’il avait envie de faire, au milieu des autres, la vie urbaine, la vie en ville, la vie dans sa propre maison, courir autour du lotissement, autour des hectares de verdure, les montées et les descentes des Buttes Chaumont, les landaus du parc Montceau, les appareils photo et les cannes à selfie des Tuileries
courir courir comme s’il en allait de notre vie, courir autour, courir encore courir, chevilles et genoux coudes au corps, casque sur les oreilles, casquette à la tête courir, puis revenir, revenir revenir, la sueur qui marque le vêtement, les chaussures, les chaussettes qu’on vend par douzaines, les magasins à cette enseigne, nous autres humains courir même s’il pleut, courir et encore courir après l’avenir, le matin plus que le soir, mais la nuit oui, courir, avancer droit devant soi, à la nuit et puis, à un moment cesser















 il s’agissait d’enquêter de nuit, un spectacle autour d’une exposition, ou l’inverse, électrique, flippers et musique à rompre les tympans (électronique, deux pistes de danse, des jeunes gens soûls et défoncés, qui n’en a pas vu ou croisé ? jusque cinq heures, approcher les personnes qui sortent je me souviens de ce travail, l’un des plus difficiles) (un autre sur la projection en continu – huit heures du soir/neuf heures du matin – du feuilleton « Berlin Alexander platz », on sortait de là ébahis…), j’ai été remercié (c’est ainsi qu’on dit) pour ce travail, les gens sont encore sans doute en place j’imagine (TNPPI pourtant, je sais bien)
il s’agissait d’enquêter de nuit, un spectacle autour d’une exposition, ou l’inverse, électrique, flippers et musique à rompre les tympans (électronique, deux pistes de danse, des jeunes gens soûls et défoncés, qui n’en a pas vu ou croisé ? jusque cinq heures, approcher les personnes qui sortent je me souviens de ce travail, l’un des plus difficiles) (un autre sur la projection en continu – huit heures du soir/neuf heures du matin – du feuilleton « Berlin Alexander platz », on sortait de là ébahis…), j’ai été remercié (c’est ainsi qu’on dit) pour ce travail, les gens sont encore sans doute en place j’imagine (TNPPI pourtant, je sais bien)