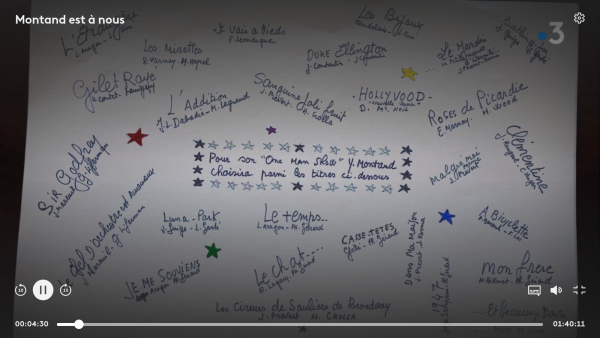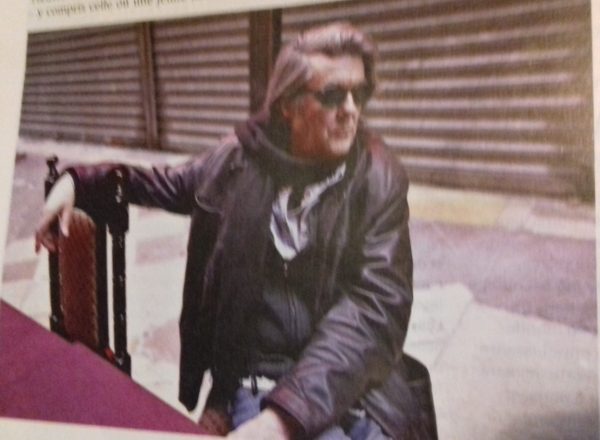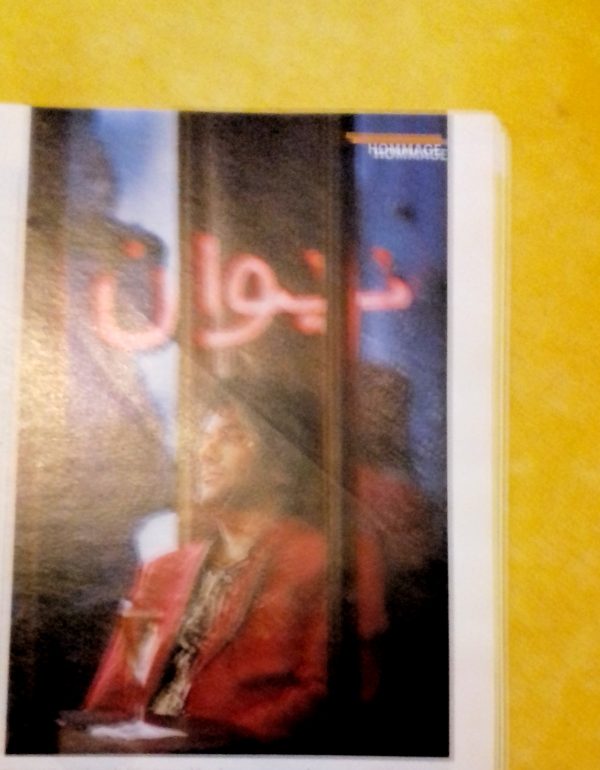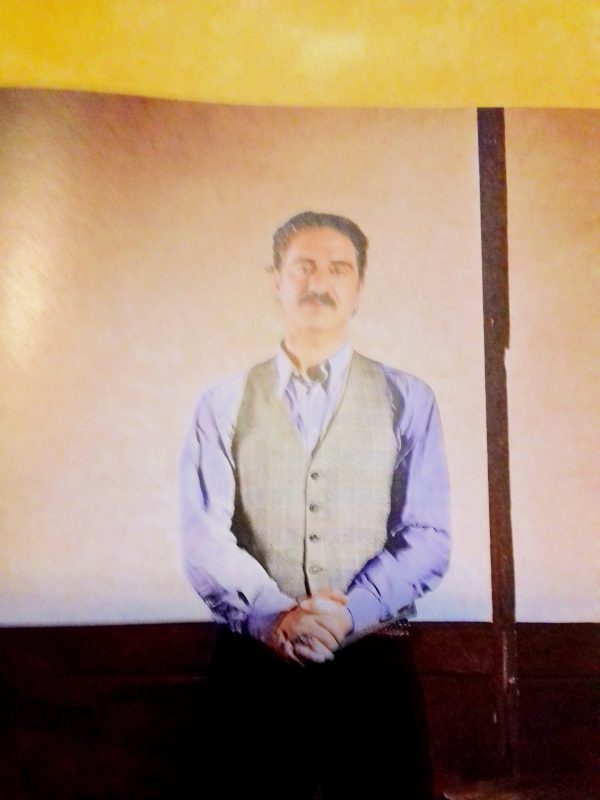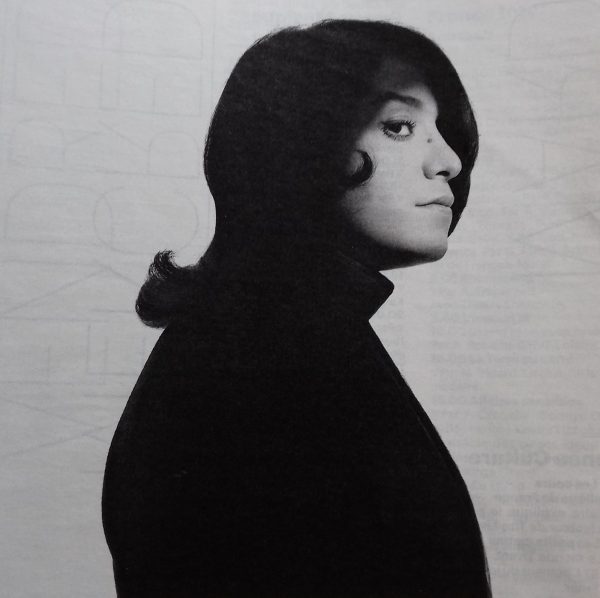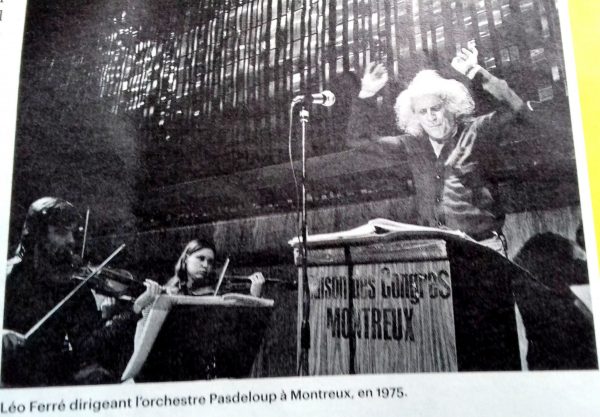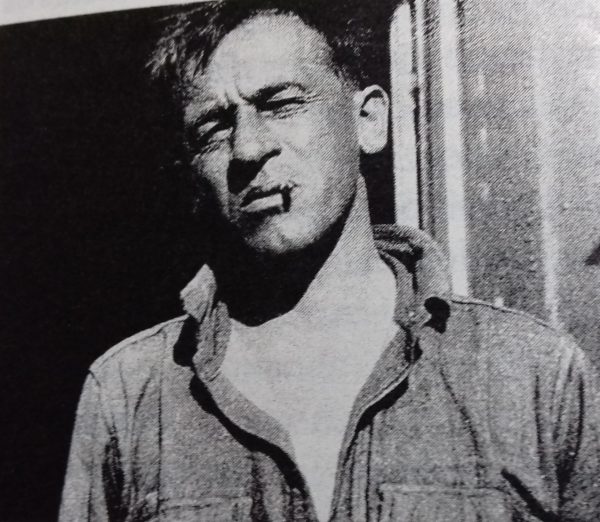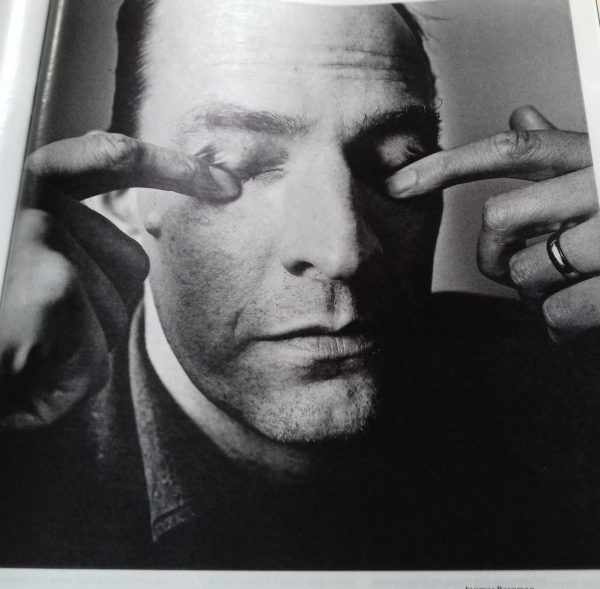à Becky Moses

un de ces jours, il faudra faire en sorte que ce qui se passe en maison[s]témoin ne parte pas sans index – j’y pense depuis un moment sans parvenir à résoudre cette possibilité – mais un autre index (me) devient nécessaire (les nécessités aboutissent toujours à un travail d’ampleur inattendue mais devant le clavier, assis au chaud (blanc hétéro pacsé retraité sans doute dans le statut social) (enfin de multiples avantages, disons) l’inspiration de celles et ceux qui font réellement quelque chose est toujours porteuse – il me semble – en tout cas je fais en sorte que – j’écris pour que le temp passe – lequel, ce faisant, me conduit où tu sais – je n’ai pas vécu de guerre, dieu merci (comme disait mané) ou j’en sais rien je veux dire : dieu ? merci ? j’en sais rien – je préfère sans doute écouter une chanson (par exemple « I’m on the dark side of the road » qui me fait faire retour sur la vente de ses chansons par Bob Dylan –
bon le 25 avril marque une date libératoire du fascisme (1945) fin de la guerre en Italie et le reste aussi – ne pas oublier, et les ami.es Portugais.es aussi – un bien beau jour qu’aujourd’hui –
– ce monde, ce monde-là, celui du divertissement sûrement, comme ce que je fais ici) (je me divertis) mais faisant connaître si ce n’est fait encore des personnes pour qui le monde compte (comme pour moi) – manière de résister, certainement, aujourd’hui que l’ordure brunâtre s’est à peine éloigné – ce racisme répugnant porté par une presque soixantenaire (née le 5 août 68, ça ne peut pas s’inventer) fille de tortionnaire et de voleur – que le sensiblement égal en plus hypocrite en a repris pour cinq ans – aujourd’hui donc vingt-cinq avril débute une façon d’hommage au travail accompli en Italie par Domenico Lucano condamné par la justice de son pays mais surtout par la raison d’État, lequel est tenu comme depuis un siècle (un siècle…) par le fascisme le plus immonde – les choses changent ? je n’en ai guère l’impression… (dire que je vais émigrer un jour, inch allah (comme diraient quelques ami.es) dans le nord de cette péninsule…) n’importe : l’affaire se déroule quelque part par ici
un peu à l’ouest de Monasterace Marina, un village, à quelques kilomètres de la mer (une extension dudit, Riace Marina montre son image
) par là
j’y suis arrivé par l’est, et dès que je l’ai vue
on la discerne à peine, droite cadre, presqu’en haut de la colline, semblant abandonnée
plus près
rapprochée
j’ai pensé qu’elle pourrait être pour moi – j’étais dans un état d’esprit procuré par le livre de Mimmo, le maire de Riace : Grâce à eux, Comment les migrants ont sauvé mon village (Buchet Chastel, 2021),lequel se termine par une évocation des chèvres
nombreuses semble-t-il dans ce si beau pays, si désolé – on voit ici, droite cadre, le chevrier de dos
j’allai voir ce village non pas en touriste (je n’aime pas le tourisme) mais en éclaireur – je me prépare à émigrer (je dois dire, peut-être ici, en cette maison, que mes premières années sur ce monde, se vécurent sous l’égide d’un aphorisme qui m’est resté « la valise ou le cercueil » qui s’adressait plus aux pieds-noirs et autres harkis du pays voisin, je reconnais, mais qui m’a marqué que je veuille ou pas) j’irais en Italie, il y fait plus doux (j’aime ma liberté, peut-être irais-je en Grèce, une île – je rêve – je me demande – j’élabore – j’imagine) j’entrai dans le village
dès l’entrée cette brouette (jte rapproche)
m’affirme que oui, il y a du boulot, du travail à faire, ainsi que dans la première maison repérée – le village, ici, dédié aux saints Côme et Damien qui lorsqu’on les fête (du 25 au 27 septembre) intiment aux habitants d’ouvrir leurs portes aux pèlerins – le village
qui un jour (le premier jour du mois de juillet 1998) vit arriver, en son extension maritime (Riace Marina), venant de Turquie un voilier parti le 24 juin, cent quatre-vingt quatre personnes à bord, toutes kurdes de nationalité, syrienne, turque, irakienne, iranienne.
Voilà près de vingt cinq ans : le sud de l’Italie se paupérise, les mafias pullulent, les réfugiés sont esclavagisés dans des conditions ignobles, voilà vingt cinq ans (au moins) que ça dure – à ce moment-là, Mimmo Lucano pas encore maire (mais presque) , aide à les accueillir, dans la tradition, simplement, de son village. Ils et elles refondent la vie sociale grâce à leur travail sur les maisons inhabitées et abandonnées : on en recherche les propriétaires, on leur demande l’autorisation de remettre en état leurs propriétés, ils acceptent et en échange permettent d’y vivre, on y travaille et les choses se passent. Normalement c’est à dire humainement. Il y a moyen d’espérer.
Les habitants du village élirent Mimmo (Mimmo le Kurde…) maire. On mit en place des nombreux dispositifs pour aider ces « damnés de la terre » que sont les réfugiés de quelque pays que ce soit. Et puis comme on sait en Italie, le fascisme est toujours un peu dans sa position naturelle : il rampe. Vint l’abject salvini, un de ses affidés mit en examen Mimmo du fait de son manquement à l’administration du village : il avait signé un papier aidant une réfugiée à rester en Italie (je pense souvent à la vallée de la Roya (j’y ai travaillé un temps à enquêter le petit train qui relie Limone à Vintimille) et à Cédric Héroux qui enfin est lavé des accusations iniques portées contre lui). Condamné à 13 ans de prison, l’ex-maire (il a été défait aux élections) a fait appel ici, en France, on attend son procès. Et il n’est pas question de laisser faire : ici on exprime notre entière solidarité avec cet homme magnifique 
Le livre s’ouvre sur l’histoire de Becky Moses, qui est morte brûlée vive dans le bidonville de San Ferdinando, de l’autre côté de la presqu’île, là-même où se déroule la trilogie de Jonas Carpignano, cinéaste lui aussi impliqué dans l’accueil et la vie des réfugiés (son dernier film, A Chiara chroniqué ici). Ici aussi l’article lui est dédié : j’ai cherché
le cimetière: cette route sur la gauche de l’image y monte. J’y suis arrivé
il est dit dans le livre de Mimmo « le souvenir de Becky est avec nous pour toujours. Elle repose au cimetière de Riace, entre les niches  de la rangée la plus haute: pour la voir, il faut regarder le ciel ». Juste là.
de la rangée la plus haute: pour la voir, il faut regarder le ciel ». Juste là.
En redescendant, j’ai croisé ce garçon
qui travaille peut-être à rénover cette maison
(ces deux images datent, selon le robot (
dont j’ai trouvé aussi une image) de 2009) : la maison a cet aspect dix ans plus tard, au 22 de la rue du saint Esprit (via Spirito Santo)
J’aimerais bien demander à Mimmo comment s’appelle le type qui l’a rénovée. Je suis certain qu’il le sait. En tout cas, ça ne fait rien, ce qui est fait est fait et il fait parfois beau en Calabre. En partant, comme dans l’épilogue du livre (et comme au commencement de ce billet), j’ai croisé à nouveau ces chèvres
le chevrier et ses trois chiens blancs
Cet article, pour le 25 avril 2022 et la maison[s]témoin (zeugme), en l’honneur de tous les réfugiés du monde et de tou.tes celles et ceux qui les accueillent. Ici même paraîtra, dès que possible, l’index des noms propres et des lieux cités dans le livre.






















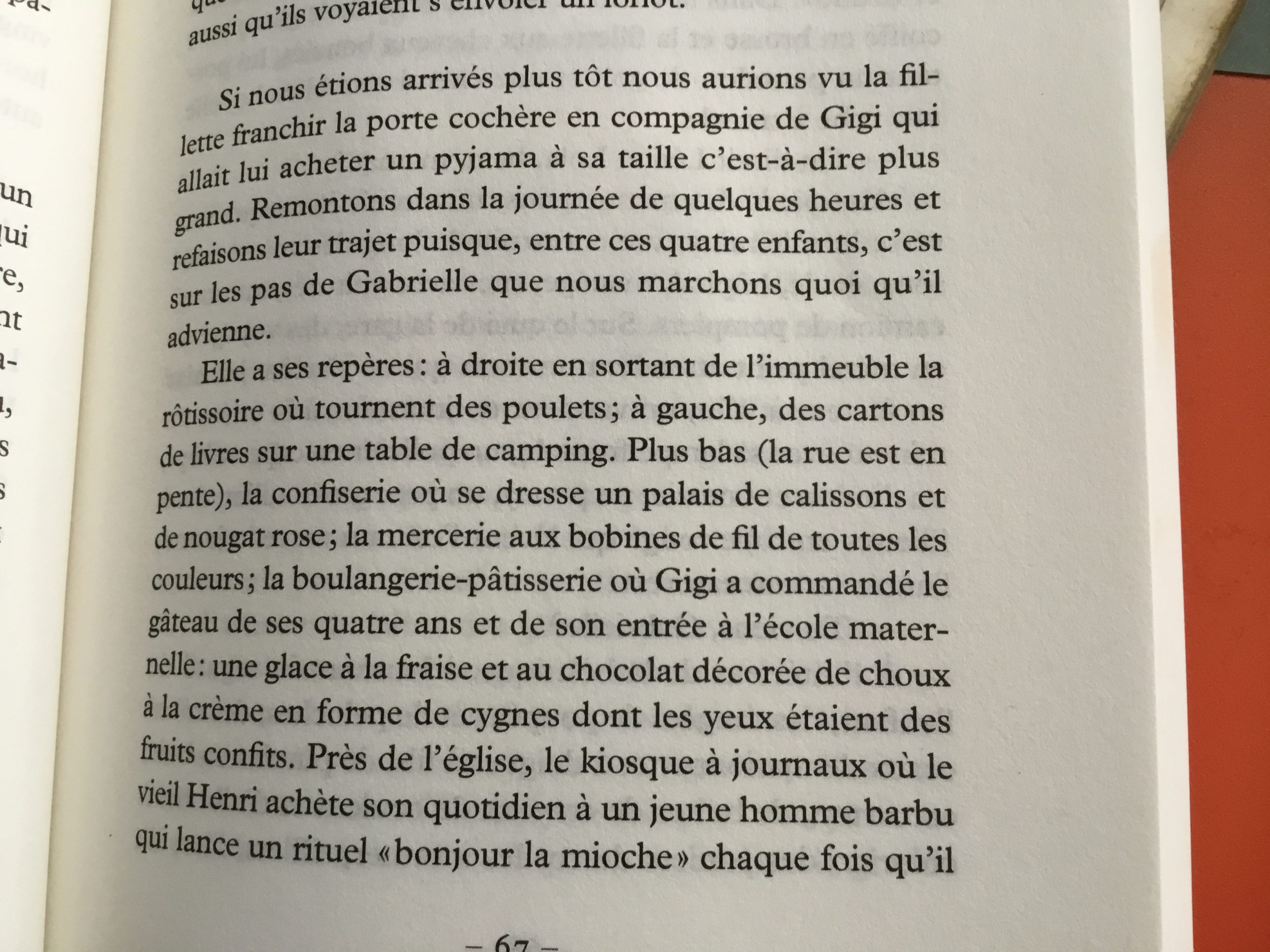
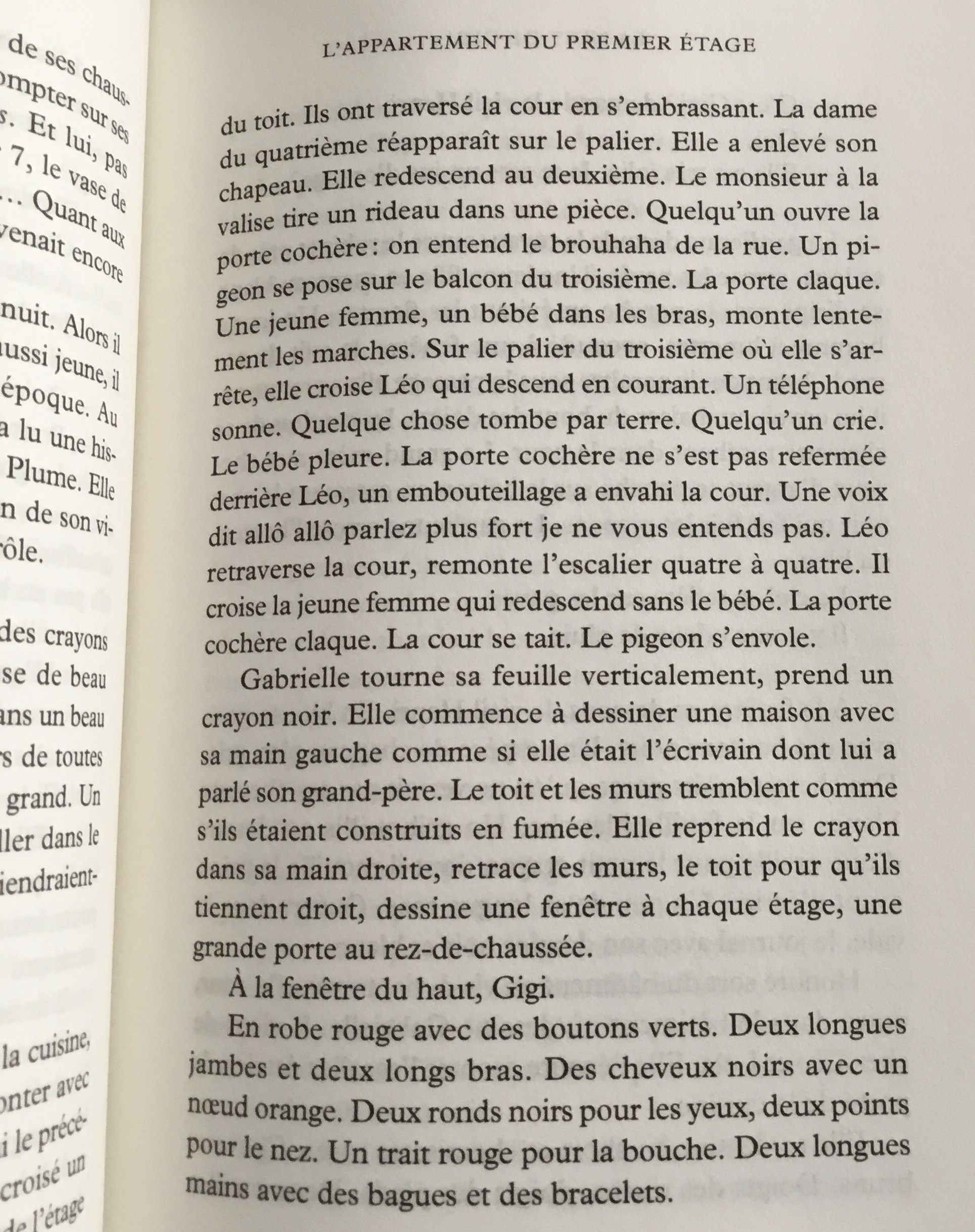

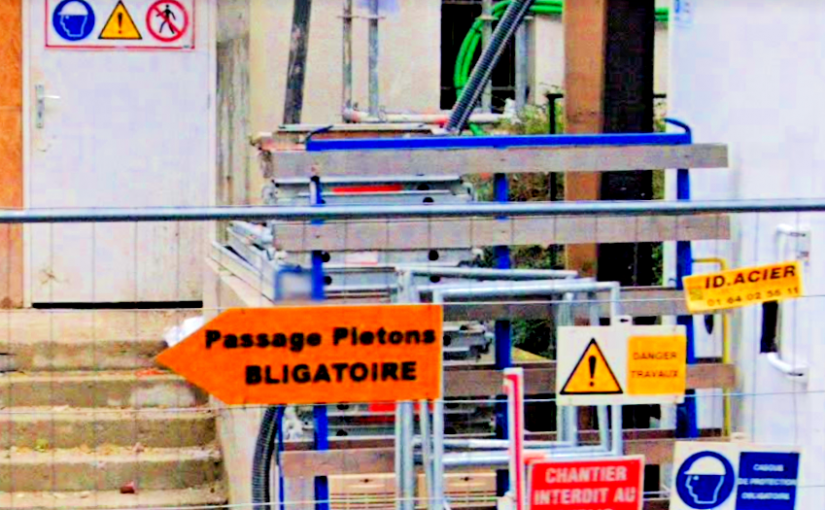









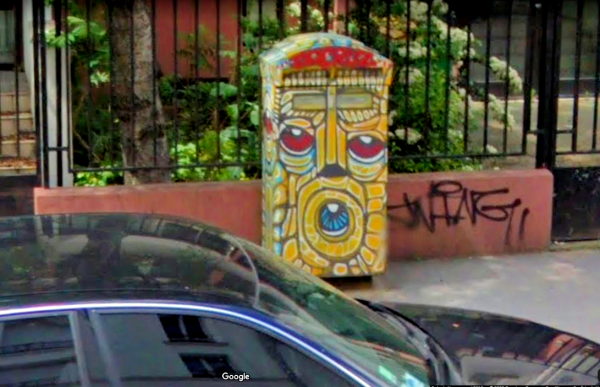





 (agence parisienne du climat
(agence parisienne du climat