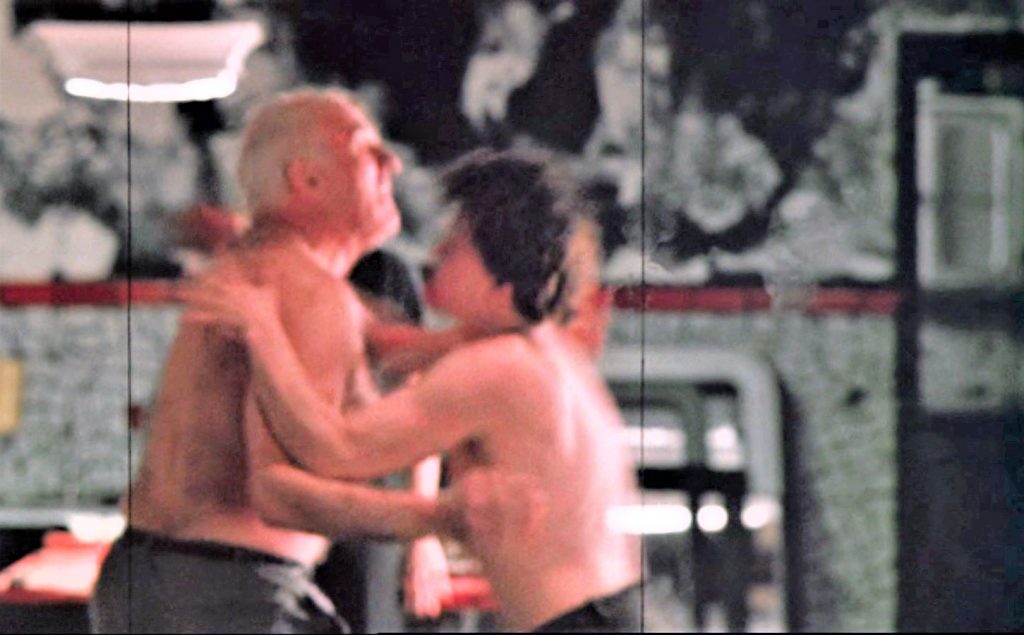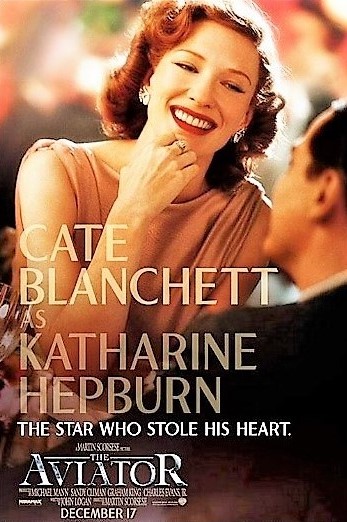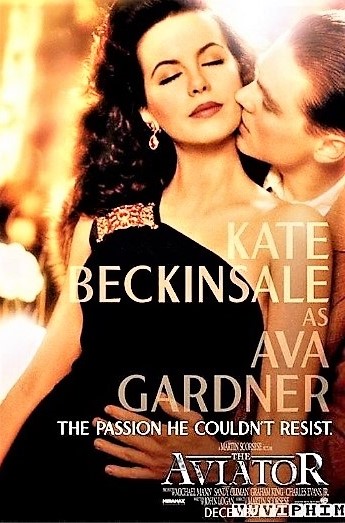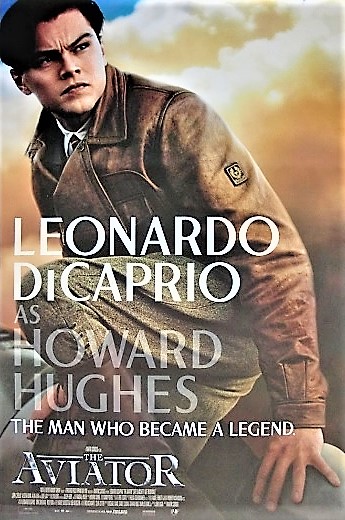T’en souvient-il de cette chanson qui fait : » la grande vie/à mon avis/c’est la vie que l’on vit/lorsque l’on s’ai-ai-aime » ? Je ne me souviens plus, peut-être Zizi Jeanmaire (prénom d’un autre siècle, pas vrai ? mais moi je l’aime bien cette dame, toujours parmi nous jte ferai dire)… Trouvée.
C’est l’histoire d’un type de peut-être seize ans qui s’en va de sa campagne (il y laisse une mère, un frère plus âgé marié père d’un enfant -on l’apprend ensuite) pour travailler en ville
(il semble – je n’ai pas fait le travail comme il faut, je n’ai pas lu l’entretien avec le réalisateur; parfois je n’ai pas le temps, je n’ai pas l’envie) (la solitude, sans doute) un boulot de merde comme on dit de nos jours (le film se déroule de nos jours, sorti en décembre 2016, présenté l’année dernière à Cannes à la Semaine de la Critique), quand le bâtiment va, tout va : c’est le cas, semble-t-il à Phnom Penh, capitale du Cambodge, située au milieu du territoire mais sur le Mékong
ici le champ : là où bossent des milliers de gens pour l’établissement de résidences ou hôtels de luxe pour « population solvable » (c’est beau comme de l’antique, l’hôtel de ville y est d’architecture greco-romaine…)
contrechamp : le fleuve – alors « Le barrage contre le Pacifique », un peu comme la mer, et celle de Marguerite (sa mère), la rue Saint-Benoît, Robert Antelme et les années cinquante, ça m’évoque et me dit à l’âme des mots et des choses qui me disposent, fatalement sans doute, très bien à l’égard du film, je le reconnais), le jeune type (il se nomme Bora dans le film – évidemment aussi voilà un prénom qui descend des montagnes sur Trieste tu sais – son nom en vrai : Sobon Nuon, simple et vrai, magnifique) est happé par la grandeur ou la beauté de la ville
 (une photo retournée et recadrée prise au dossier de presse, ici au film annonce
(une photo retournée et recadrée prise au dossier de presse, ici au film annonce le clinquant n’est pas douteux, mais n’importe), les couleurs, la joie de vivre et de côtoyer des amis, des garçons
le clinquant n’est pas douteux, mais n’importe), les couleurs, la joie de vivre et de côtoyer des amis, des garçons comme des filles
comme des filles des histoires eau de rose (comme on voit, le rose, oui), Bora retrouve un frère plus âgé lequel remarqué par un riche américain semble disposer de nombreux atouts
des histoires eau de rose (comme on voit, le rose, oui), Bora retrouve un frère plus âgé lequel remarqué par un riche américain semble disposer de nombreux atouts
il se nomme Solei (Cheanik Nov) (on ne les connaît pas, non) le voilà qui aide notre héros, les choses vivent avancent, les temps changent, la mère au loin, du coeur, s’en ira, impalpable au loin « fais attention à toi, tu as bien mangé ? » tu sais comment elles sont, et tout parle, Bora grandit sans doute, son frère lui montre la voie ou le chemin, peut-être gagner mais derrière soi abandonner (son amie, son amour, Aza – Madeza Chem – adorable
la vie qui va) nuances, charmes et douceurs, là-bas quand on ne répond pas, ça veut dire oui, trahison sans doute, aidé par un travail au son magnifique de transition et de simplicité fluide, un peu comme dans un rêve
sans tapage ni violence, une sorte de reconversion, quelques années plus tard, épilogue sans doute, Bora installé, bien coiffé propre sur lui, atteignant peut-être une espèce d’idéal légèrement frelaté, le futur se chargera (on ne le lui souhaite pas) peut-être de drames, quelque chose sourd cependant des images…
Fin.
Une merveille, « Diamond Island » de Davy Chou (sa photo en entrée de billet).
Dans la bibliothèque des dvd de la maison(s)témoin, à l’extérieur parce que le monde bouge plutôt à l’extérieur, ici il n’est pas douteux qu’on trouve des appartements témoin : voilà une photo pour illustrer le monde de la vraie vie, dans la salle à manger… (Building G, Koh Pich – Diamond Island en khmer – photo copyright Narun Ouk)
Bon appétit…








 le père absent
le père absent même façon de penser : le petit Aliocha (ici il pleure, oui)
même façon de penser : le petit Aliocha (ici il pleure, oui) les gêne, il les ennuie, il ne leur sert à rien, il les encombre – il est sans doute la chose (oui, la chose) qu’il ne leur fallait pas faire. Une chose, c’est ainsi qu’ils le conçoivent. On sent qu’ils ne font ainsi que transmettre ce qu’on leur a transmis (sans qu’ils le sachent). C’est après le premier tiers du film que cette image apparaît
les gêne, il les ennuie, il ne leur sert à rien, il les encombre – il est sans doute la chose (oui, la chose) qu’il ne leur fallait pas faire. Une chose, c’est ainsi qu’ils le conçoivent. On sent qu’ils ne font ainsi que transmettre ce qu’on leur a transmis (sans qu’ils le sachent). C’est après le premier tiers du film que cette image apparaît suivie de celle-ci
suivie de celle-ci puis plus rien d’Aliocha.
puis plus rien d’Aliocha. Décidément, non, on ne le retrouvera pas. Douze ans, un mètre cinquante, blond. Plus jamais. Cela semble tant mieux : l’homme se retrouve chez la femme qui attend un enfant de lui (il le traitera comme il a traité Aliocha…); la femme chez un riche homme seul (une fille à Lisbonne à laquelle il parle, de temps à autre, via internet, et ce sera tout). L’allégorie limpide d’une Russie de nos jours : ici la jeune femme qui court toute seule
Décidément, non, on ne le retrouvera pas. Douze ans, un mètre cinquante, blond. Plus jamais. Cela semble tant mieux : l’homme se retrouve chez la femme qui attend un enfant de lui (il le traitera comme il a traité Aliocha…); la femme chez un riche homme seul (une fille à Lisbonne à laquelle il parle, de temps à autre, via internet, et ce sera tout). L’allégorie limpide d’une Russie de nos jours : ici la jeune femme qui court toute seule































 Passaic en couleurs, Union avenue, feu tricolore dans les jaunes, numéros disproportionnés, visibles des autos je suppose, en tout cas il fait beau
Passaic en couleurs, Union avenue, feu tricolore dans les jaunes, numéros disproportionnés, visibles des autos je suppose, en tout cas il fait beau















 ce n’est pas que ce soit vilain, non
ce n’est pas que ce soit vilain, non