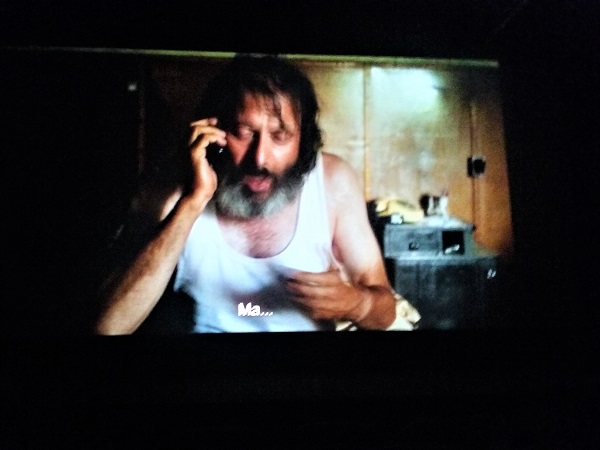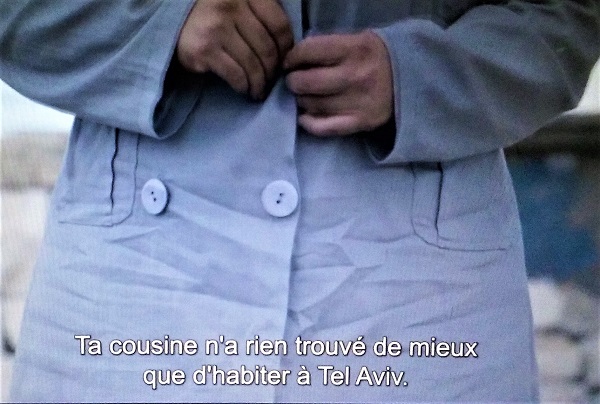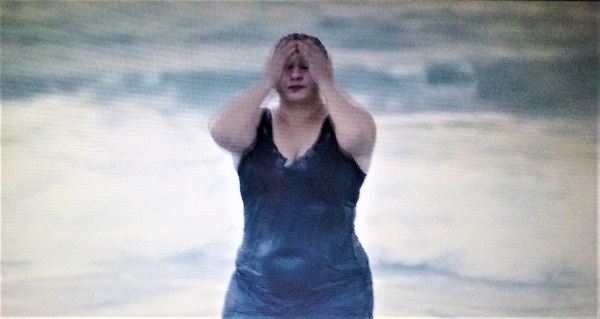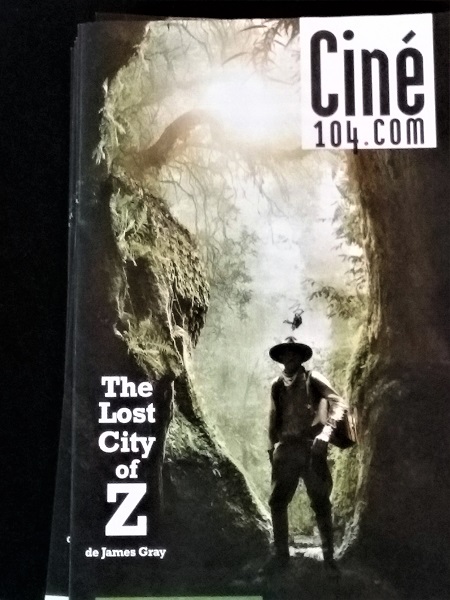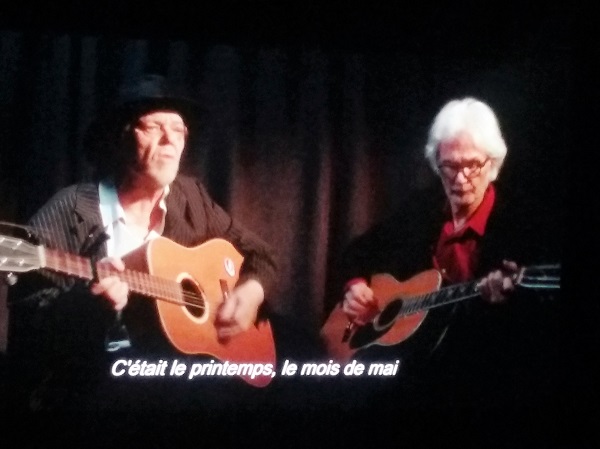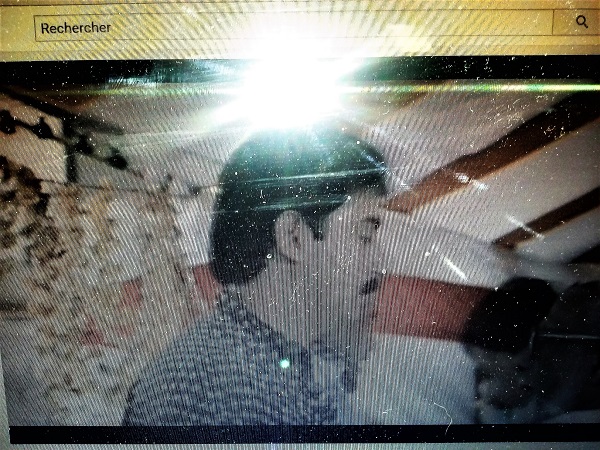Peut-être s’agit-il d’un exercice, critique probablement, sur un texte que j’ai lu parce que je regarde souvent le site du désordre (commencez par le blog, c’est juste un truc incroyable), et que ce texte-ci est tellement ordonné : techniquement, il n’y a qu’une seule phrase, le livre – qui compte 208 pages – le texte – commence à 9, se clôt à 198 – s’achève par les lieux où s’est déroulée pratiquée l’écriture dicelui, et ses dates d’élaboration (de 2003 à 2016), il débute d’une majuscule au « JE » que je n’avais pas remarquée – mais aussi ces capitales d’imprimerie sur deux autres mots « JE VOUS ARRETE » dit-il – il y a un accent circonflexe sur le deuxième « E » de arrête mais je ne l’ai pas en capitale sous la main – je n’avais pas rouvert l’exemplaire acheté en bas de la rue du Jourdain, j’avais écrit ce qui me venait (sur le cahier noir acheté à Thessalonique cet été), et j’avais retranscrit ce que j’avais écrit ici ayant toutefois cherché quelques illustrations parce que le titre m’évoquait quelque chose que j’ignorais être un épisode biblique ou alors dans des limbes bien improbables et oubliées depuis (point d’études théologiques non plus que religieuses dans ma formation, disons).
Ici avant le texte proprement dit, une égide, une dédicace, un « A Sarah qui a sauvé Suzanne » qui peut suggérer que cette dernière a failli se soustraire à la représentation, et qui explique sans doute quelque chose de la fiction que j’ai diagnostiquée s’il n’est pas trop impropre d’employer ce verbe pour une lecture attentive, certes, mais une lecture comme une autre. J’ai pris la page 48 de l’ouvrage, et j’y ai compté trente cinq fois le signe du point surmontant la virgule (fois 191 égalent et donnent 6685) et je me suis dit que de la lire à haute voix (me) serait assez difficile – trop de libido, trop d’intime, trop de crudité sans doute… sans doute. Il y a bien des dialogues mais ils ne sont pas solidifiés par les tirets ou les guillemets. On ne fait pas dans la norme, voilà tout. C’est le livre qui est ainsi, donc il est comme il est, je l’ai lu, j’en trace ici une sorte de représentation. Je suppose qu’elle paraîtra ici comme sur pendant le week-end, je ne sais où, mais je n’en suis pas tout à fait certain ( si cela est, je poserais alors un lien). Je fais tourner « Song song » par Brad Mehldau, je me souviens de 1 5 2 3 0 4 tout en me remémorant avoir croisé une 304 aux sièges de cuir marron clair dimanche dernier, mais elle était turquoise, sans en prendre photo qui aurait été une bonne illustration, mais tant pis, et je recopie.
Mise à jour ,au point, du 10 avril 17 : j’ai repéré quelques points d’interrogation mais qui ne terminent pas la phrase, j’ai remis le livre dans la bibliothèque, et Brad Meldhau encore.
Les choses se marquent, mais rien ne se crée, tu vois, et c’est parfois quelque chose qui m’intime de cesser : non, je continue, encore.
De rompre le pacte de lecture, en deux actes :
1. les points-virgules : artifice, scansions, cesser de penser en rond suivant une syntaxe, poser du code à la place (en un sens : par exemple, c’est juste un exemple) (sic sans point-virgule)
Au fond, le rangement des choses, ou des signes soit un point contre trente cinq (en moyenne) signes de ponctuation par page, soit tant (6685 dis-je) de signes. Pourquoi faire ?
2. la même question pour le titre ; s’il s’agit d’une fuite en avant ; du fait des turpitudes du présent/Est-ce bien le cas /On attend, petit à petit sans doute/On connaît et on reconnaît/On retrouve des rêves/ou des fantasmes/c’est bondé de fantasmes
Du slash au point-virgule
L’apparition de dessins serrés dans un carton/Laquelle est-ce, de fuite ? Celle d’Autun

en bas relief, le charpentier son(?) fils(?) et l’âne (et non un rhinocéros)/Et la mère (enfin, est-ce bien une mère, une mère porte un enfant, elle, le porta-t-elle ?) (toute cette imagerie donc qui fait un simple écho, il s’agit d’une fuite et non de « la » fuite – écho notamment « Rosemary’s baby« (Roman Polanski, 1968), où elle le porte)
Il y en a d’autres, plus profanes : celle de Francisco de Zurbaran – ils vont de droite à gauche – ou de Goya

ils viennent vers nous et vont sortir droite cadre (ça vient de la Binaf), ou celle-ci magnifique de je ne sais plus qui

(on fait un petit somme en attendant le jour et on s’en va) (je crois que ça se trouve au musée des beaux-arts de Boston – Louis-Olivier Merson)
Se souvenir de ses rêves
Des évocations, ça ne fait rien, je continue, je lis sans me poser trop de questions, une fiction tragique, c’est ainsi, c’est ce que c’est.
Oblitération on ne parle pas de ça, les parents (du narrateur) peut-être ? Mais on n’en parle pas (un peu du frère). On parle de ceux d’elle, cependant. Ou de cette maison, puisque de là, elle vient ( elle revient). On peut voir la tête de rhinocéros/la couverture/le site/la page/le livre/le prix/ Construire une histoire ou révéler le passé ou la fuite de qui / Une fuite de qui
« Où ? » ce serait une autre question.
La jamais prénommée aussi qui conduit la voiture (cent six diesel) sur laquelle foncera ce type saoul au volant de sa camionnette (je crois des boites de sardines) sur les genoux le moteur et la mort instantanée, c’est la nuit, elle, et la photo, oui, la photo, laissant derrière elle deux enfants en bas-âge, le veuvage vaut-il seulement par les sacrements ? La mère de ces enfants-là/irrémédiable/les comme premiers mots du fils qui sont ceux d’Antoine Doisnel/
Puis celle qu’il appelle/parfois on pense à l’irruption de la fiction, juste là/il aurait appelé ses deux amis, je ne sais plus/nommée et prénommée, les deux c’est important les deux, nom et prénom, c’est important/Suzanne/une sorte de haine de la part de la fille/rien de la part du fils/d’où la sort-elle cette haine-là ? Les enfants, le garage, le VSD, les collègues de bureau, l’enveloppe, la complaisance, si c’est pour en faire ça/ les sentiments abjects – ailleurs que la sexualité, l’argent, les problèmes qui se résolvent comme par magie – un enchantement – alors que ce sont eux peut-être qui la firent fuir – eux, les problèmes – chez sa mère, le guéridon, la route droite qui défile, la nuit (ici de jour prise sur le site

je ne sais pas, est-ce elle ? Je m’en doute).
Beaucoup de libido comme si cette perte suscitait quelque chose
A-t-on/a-t-il perdu quelque chose ? Se prononcer sur l’amour qu’il lui portait, venait- elle, revenait-elle rompre ou annoncer que décidément non ? On ne saura jamais quels discours, quels sentiments elle lui portait, la route est là, la nuit elle rentre, il ne lui a pas dit « je t’embrasse » pour que l’échange dure un moment encore, et puis elle est partie elle revenait et l’accident
On peut remarquer que cette ponctuation inflige des majuscules aux seuls noms propres, et que l’innommée n’en bénéficie pas – on n’a pas vraiment le sens commun pour indiquer si le narrateur en jouit, mais il faudrait relire, peut-être si on l’invective, lui, ce narrateur, je ne me souviens plus si lui est nommé je ne sais plus, j’en termine
Une fuite en Egypte (Philippe de Jonckheere, inculte, 2017)
 Ni fiction, ni documentaire. Il y a là quelque chose qui intéresse. Une histoire de chance (en italien « fortuna ») – c’est un film italien, « Mister Universo » – un jeune homme (ici à l’image) recherche sa chance (il l’a perdue, on la lui a volée) et va voir ses connaissances (ses tantes, ses oncles, es parents sa famille, tous aussi nomades que lui). Lui est dompteur (un espèce de monsieur Loyal ( habit bleu souligné de rouge, parlant aux fauves, les amadouant, les connaissant, comme des âmes soeurs…). La relation avec les enfants est une sorte d’invariant formidable
Ni fiction, ni documentaire. Il y a là quelque chose qui intéresse. Une histoire de chance (en italien « fortuna ») – c’est un film italien, « Mister Universo » – un jeune homme (ici à l’image) recherche sa chance (il l’a perdue, on la lui a volée) et va voir ses connaissances (ses tantes, ses oncles, es parents sa famille, tous aussi nomades que lui). Lui est dompteur (un espèce de monsieur Loyal ( habit bleu souligné de rouge, parlant aux fauves, les amadouant, les connaissant, comme des âmes soeurs…). La relation avec les enfants est une sorte d’invariant formidable (on devrait poser un #294 ici, mais enfin passons), chercher, rechercher, suivre, trouver les traces, les pas et les passages, et enfin, oui
(on devrait poser un #294 ici, mais enfin passons), chercher, rechercher, suivre, trouver les traces, les pas et les passages, et enfin, oui