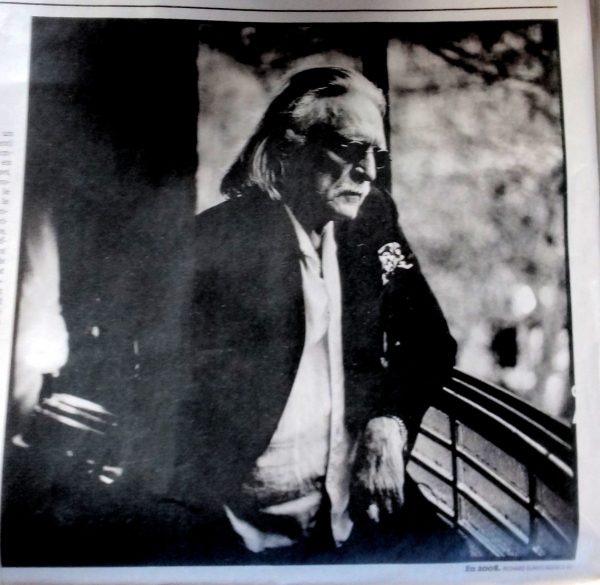c’est difficile à dire (pense, en lui-même l’agent) (enfin je crois : je le vois, bras croisés, devant la baie qui domine le petit jardin, lequel descend, en douce, vers le rond-point qui ne sert à rien au fond du lotissement – mais je m’égare) mais le monde est tel qu’il est (comme on voit l’agent divague) (je ne sais pourquoi il faut lui donner la parole – il arrive que certaines corporations soient formées d’abrutis notoires) (je ne vais pas citer le sabre, le goupillon, la matraque ou la gégène hein) (non je ne vais pas) regardez le monde tel qu’il est : vers vingt et une heure locale, plus personne dans les rues, je ne veux voir qu’une tête (il y aura bien un esclave à vélo uber pour porter à manger aux malheureux; aux malheureuses) – hier je rentrais de la campagne, le train a mis sept heures au lieu des deux et demie annoncée pour faire son parcours – on nous a fait changer de machine parce que celle où on était assis devait repartir dans l’autre sens, tu comprends bien, pour être là-bas demain matin, bien sûr, cette blague, afin de faire le même chemin en partant de là-bas le matin, tu as compris ? et donc par la vitre les rues de la banlieue vide c’en était à pleurer de rage ou de dépit – c’est sans image – je vais en poser quand même parce que, dans la maison, on fait des travaux (petits, des bricoles) (nature morte au briquet (1) rouge)
ce ne sont pas clichés intentionnels (enfin ils le sont toujours, mais ils n’étaient pas destinés à illustrer ici ce billet d’humeur) ce sont des outils – on s’en sert pour des usages particuliers – j’ai été tellement outré par ces annonces, celles du 16 mars sans doute, celle de ce « couvre-feu »- ces « nous sommes en guerre » et celle, de guerre, que mène donc ce gouvernement à sa jeunesse – et à ses gilets jaunes – à sa jeunesse qu’on veut déposséder de sa culture et de son éducation (tu vois cette loi programmation recherche, cette honte ?) – tu sais à quoi me fait penser ce cintré bleu dont les beaux-enfants ouvrent des écoles (privées hein) ou se placent dans quelques officines consultantes ? (nature morte au briquet (2) vert)
on la prive de sa joie de vivre pourquoi pas après tout ? on fait quoi, quand on a vingt ans, à neuf du soir ? on regarde netwhatthefuckflix ? Tu te rappelles, il y a quelques années les gueules cassées, les estropiés, peut-être moins que les planqués (c’est possible, tout est possible sur ce monde) disaient d’eux « ce qu’il leur faudrait c’est une bonne guerre » est-ce que tu te rappelles de ce genre de saloperie très troisième république blouse grise et écoles des filles et des garçons séparées on ne veut voir qu’une tête – est-ce que tu t’en souviens… ?
Moi oui.
Ah cette maison[serait-elle][s]témoin… Non, on ne fait pas de visite le soir, vers neuf heures, non ou alors très rarement… J’ai regardé au loin, à un moment de la promenade – bien sûr j’ai des enfants si on peut parler comme ça, bien sûr le temps passe (on oubliera peut-être), mais vraiment, pour protéger des soignants qu’on a laissé choir ces six derniers mois ? pour ne pas « investir » comme ils disent ? – j’ai regardé au loin
c’est vrai, ça ne fait rien – il fait beau; le jour se lèvera sûrement demain. Ça ne fait rien, et le soir, vers neuf heures, il n’y a plus personne dans les rues
ce sont des choses qui sont difficiles à dire